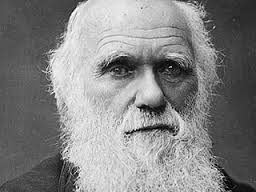par Karim Moutarrif
Je me suis baigné dans la rivière, tôt le matin, dans un silence irréel, une rivière non polluée, au milieu d’immenses galets qui avaient dû être transportés il y a bien longtemps par des glaciers d’une autre ère. Au bout du monde, un silence troublé quelquefois par un bruit de véhicule qu’on aurait voulu éradiquer de la bande son, mais surtout par les ânes, les chèvres, les chevaux et les coqs. J’avais perdu l’habitude de l’existence de ces êtres là aussi.
Un luxe dont l’Occident m’avait dépossédé, sauf dans l’immensité écrasante de l’Amérique. Et même là-bas, il fallait l’entremise de la technologie pour y accéder.
J’étais venu avec la peur du choc après une si longue absence, mais ce ne fut que continuité dans des changements notables. Ailleurs cet endroit serait dans un parc naturel. Une exclusivité délaissée.
Je savais que je reviendrais en arrière dans le temps.
Le voyage à la montagne fut une excellente occasion de se perdre. On pouvait même y faire des rencontres en dehors du temps. Un paysan, plutôt de bonne humeur, que nous avons croisé avait dit, « Si tu es bien dans ta folie pourquoi cherche tu la raison ? » Lui le montagnard, qui, selon les apparences n’avait jamais quitté le pied de la montagne, dispensait des pensées surréalistes au vent, à qui l’entendra. Un fou qui colportait les propos d’un sage.

Il n’y avait pas d’horloge et le mouvement du soleil restait la seule référence. Mais ce qu’il disait était sensé et je pensais qu’il n’y avait pas de hasard, qu’il m’avait laissé un message.
Je me gardais bien de demander l’heure à mes coreligionnaires, tous très bien équipés des derniers gadgets de l’Occident, portables et autres montres synthétiques. J’avais quelques jours pour réduire l’activité cérébrale au strict minimum, pour me laisser porter par cette langueur ambiante dans laquelle personne n’exprimait quelque inquiétude que ce soit.
D’ailleurs on se sentait y glisser irrésistiblement jusqu’à l’impression que le temps s’est arrêté, que plus rien ne se passera, que jamais on pourra s’en libérer. Jusqu’à l’étouffement.
Méditer.
Il fallait que je maintienne le fil de l’écriture, trop d’événements se bousculaient à l’entrée de ma raison.
Les choses restaient toujours dans le flou, rien n’avait changé.
La prise en otage, la désagréable impossibilité de dire quoi que ce soit. La liberté déjà brimée dans les rapports intimes, avant de quitter le foyer, vous avez déjà un aperçu de ce qui se passera dehors Un mal être qui se répercute sur les autres. C’est dans ce contexte aussi que je fis ce qu’ils appellent un retour aux sources. En toile de fond il y avait la misère dans une société qui ressemblait plus à une jungle qu’à autre chose, plus qu’ailleurs. La loi du plus fort était la seule. Les plus faibles se résigneront à leur sort. La souffrance dans les visages des gens dans la rue, les trottoirs éventrés, les grosses mercedes. Dans beaucoup d’expressions, la résignation aussi. Une pyramide de petits pouvoirs qui régissaient ainsi toute une lande. Je sentis très fortement la pression virtuelle mais bienveillante que me fit Charles à l’épaule. En Angleterre, c’était crado aussi au moment de la Révolution industrielle. Ici, il n’y a jamais de révolution, jamais eu de pays. Ceux du Sud n’ont jamais rencontré ceux du Nord. C’est un mariage forcé.
Je suis venu constater que plus rien ne serait comme avant.
C’était comme attendre le facteur au bord de la route, le voir passer et vous faire dire qu’il n’y a rien pour vous.
Loin de ma fille, je la languissais. Nos discussions, nos câlins, nos promenades, nos solitudes, sa joie et sa bonne humeur, ses créations, ses projets me faisaient défaut. Heureusement qu’il y avait l’écriture pour colmater la brèche.
Ici aussi j’avais trouvé un ordinateur. Ici, j’étais « rentré au pays », loin de la France et du Canada.
De la fenêtre de la maison où je logeais je voyais la carrière qui avait été envahie il y a longtemps par des squatters devenus depuis propriétaires.

« Vieux à vendre » disait la voix depuis des siècles. Il y avait encore et toujours, ces acheteurs de vieux. Chacun chantait sa chanson dans son style y ajoutant bouilloire ou théière ou ferraille. écaille écaille écaille Dans la ville des corsaires et du djihad maritime, un terme qui était très d’actualité mais sur terre cette fois.
J’étais cloîtré, quand je sortais un petit moment j’avais suffisamment d’images pour méditer le restant de la journée. Une chose était sûre, je ne pouvais plus vivre ici, j’étais une fausse note et venir le constater me soulageait pour les derniers doutes que j’avais. J’avais déjà donné douze ans de ma vie, ce qui n’était qu’une broutille.
Hier le sort du monde se jouait dans une élection, celle de l’Empereur éponyme et le monde entier attendait fébrile, l’issue : Va-t-il être bon ou méchant le prochain président ? C’était quand même dérisoire à quoi tenait le destin de l’humanité. Le lendemain, nous nous sommes relevés avec la gueule de bois. Une chose s’achevait, une autre commençait.
J’avais cherché au pif, dans ce pays où un homme ne peut pas parler à une femme sans se faire surveiller, les traces de mon passé, de mes amours impossibles. J’avais retrouvé le nom de son frère, cette blonde d’il y a 24 ans. Sa maman allait bien, elle avait les problèmes de santé de l’âge.
« J’ai gardé le foulard que tu m’avais offert et les lettres fleur bleue que tu m’écrivais. Tu es le premier garçon qui m’a embrassé. Je vis seule, je suis mieux. » C’est ce que j’ai retenu de l’échange téléphonique. Le seul que nous eûmes.
Connaissant les susceptibilités ambiantes, je me suis présenté sur la pointe des pieds mais le message est parvenu. J’étais heureux. Le ton était chaleureux au téléphone ! En fait elle ne me rappellera plus et je ne la reverrais pas comme je l’avais espéré.
Puis je me suis enquis d’une visite à l’école où j’avais été formé. Là où il n’y avait plus de traces de moi.
Tout avait changé.
J’ai pleuré devant ce désert. Vingt sept ans, toute une vie. J’ai demandé son âge à un répétiteur qui s’étonnait de ce que je faisais là avec mon badge de visiteur, dans ce territoire qui avait été le mien, dans une illusion passée, « Vingt sept ans », je lui ai dit, « j’ai quitté quand tu es né ». Il en fut interloqué. Une bande de lycéennes ont débouché du tunnel, j’ai vu ma dernière parmi elles, elle avait le même âge. Je me suis rendu compte pour la première fois de la fragilité de cet âge.
Brutalement j’ai revu tout ce que j’avais traversé.
Je suis ressorti comme chassé d’un monde qui n’était plus le mien, avec le sentiment d’avoir été dépossédé. Il ne restait que des fantômes, de ces armées de professeurs, de pions, de surveillants généraux qui avaient contribué à mon cheminement. A l’évidence beaucoup d’entre eux n’étaient plus de ce monde.
J’ai refait le chemin de l’écolier que j’empruntais autrefois, il ne restait que la route, tout le reste avait changé. Les villas avaient progressivement été remplacées par des immeubles. La physionomie avait été remodelée, dans un bâti sans goût ni cohérence. Le quartier avait changé, violemment.
Je vieillissais.

Juste écrire, des fois c’est vital. Je sentais bien que je déprimais quand je ne pouvais pas brancher cette machine dont j’étais devenu dépendant. Juste pour colmater les bleus.
Mon ami me disait qu’il chattait comme ils disent mais qu’il ne pouvait rien conserver. La machine n’autorisait pas l’opération. Il ne doit pas rester de traces de vous, c’est confidentiel. On saisit ainsi chaque fois un peu plus le sens du mot virtuel comme vivre dans un rêve. Les langues mouraient chaque jour un peu plus sous les doigts des internautes pressés de communiquer. Tous les claviers y passent. Le temps de la machine devient la référence
Quand le virus a planté ma machine et que j’ai du réinstaller tout le système, mes fichiers avaient disparus à jamais. Heureusement je les avais immortalisés sur un disque compact. Au moment où j’avais tant de choses à dire, où ce que je ressentais partait en fumée au coin d’une autre idée et la tristesse d’en faire des orphelines perdues à jamais aussi.
La chose que je notais le plus c’était cette marque des années sur les corps et tous ces morts sur la route. Je n’avais plus vingt ans.
Dans cette ville où j’avais autrefois vécu tant d’années, l’émerveillement s’était évaporé.
J’étais un bohémien de cinquante ans qui n’avait pas encore trouvé sa route. J’attendais des formalités sans le sou. Je vivais aux crochets de mon frère et de l’ami qui m’hébergeait. Je me rationnais pour ne pas abuser.
Et je repensais à ce voyage au pays des ancêtres et la squaw me disant « Tu as souffert ». « Je n’ai pas fini j’ai juste appris à le faire en silence » aurais-je du répondre mais je ne voulais pas entrer dans les détails, en rajouter.
A l’heure qu’il était j’étais seul et j’aurais voulu parler à un être exquis qui m’aurait écouté en acquiesant de la tête, en appuyant mon propos.
J’étais reparti ailleurs. Paris XIVe.
Je suis allé là-bas à cet endroit où je l’avais connue, étudiant insouciant.
Mon cœur s’est serré quand j’ai regardé à travers une ouverture du portail qui donnait sur cette cour.
Il y avait un code à composer et je ne le connaissais pas. Je ne pourrais pas aller plus loin. Ma mémoire me restitue les scènes manquantes sans mal. Elles resurgissent. Juste devant les boîtes aux lettres qui étaient là, juste en entrant sur la droite. Moi vérifiant mon courrier et elle passant le porche avec ses courses.
C’est là que je l’avais croisée pour la première fois dans une sortie hâtive en peignoir de bain.