ROMEO FRATTI
Que nous disent les peintres et les poètes du XIXe siècle sur le crépuscule ? Et s’ils nous parlaient de notre inactualité contemporaine ?
« La peinture est une poésie muette et la poésie une peinture aveugle ; (…) »
La poésie du soir conduit à s’interroger sur la possibilité d’adéquation entre le mot, qui relève de l’intelligible, et la nature ou le monde ‘sensible’, au sens premier de ‘sensoriel’. Cette question pose le problème sémiotique de la fiabilité ou de la faillite des signes linguistiques pour exprimer la nature.
Si l’on tient compte de l’adage horatien « ut pictura poesis », qu’on a souvent interprété comme ʺla poésie est semblable à la peintureʺ, la réflexion semble indiquer en premier lieu que, pour décrire la nature, la poésie doit emprunter à la peinture sa capacité évocatoire et descriptive, voire invocatoire. Existe-t-il un parallélisme entre les deux arts ?
Similairement, peinture et poésie se nourrissent de l’expérience du monde, du rapport au monde de l’artiste : ces deux arts ne sont-ils donc pas également fondés sur la sensibilité sensorielle, sur l’appréhension de sensations strictement charnelles ? Mais si la peinture est un art visuel qui se saisit dans une réception sensorielle globale et immédiate ; la poésie constitue, quant à elle, un art verbal qui est le fruit d’une élaboration intellectuelle progressive. Se pose ainsi d’entrée de jeu le problème d’une inadéquation entre sensible et intelligible.
Écrire l’instant ?
La peinture est arrêt sur un instant, la littérature est déroulement temporel. En termes d’écriture, ce déroulement se traduit par l’imparfait, qui signifie une action dont le procès n’est pas achevé, à l’opposé du passé simple, qui exprime le procès dans son événement. Le passé simple a pour fonction de rompre soudainement avec les attendus de l’action, c’est pourquoi il est, dans un récit, le signe du suspens. Le passé composé indique un résultat dans un récit au passé.
La peinture possède ce contraste entre un arrière-plan et un premier plan, et ce serait le propre de la littérature que d’avoir créé une équivalence entre les plans au sens spatial et les plans au sens temporel. Le peintre devrait composer plusieurs tableaux pour rendre compte d’un déroulement chronologique ; le poète ne pourrait pas prétendre faire percevoir au lecteur l’équilibre et l’harmonie des proportions, la beauté des formes que la peinture fait voir en un seul coup d’œil. La peinture dispose des lois géométriques de la perspective pour signifier le dialogue des plans. Quant à la littérature, c’est la narration qui joue sur les plans marqués par des aspects duratifs ou terminatifs :
« Longtemps muets, nous contemplâmes
Le ciel où s’éteignait le jour.»
« Hier, le vent du soir, (…),
Nous apportait l’odeur des fleurs qui s’ouvrent tard ;
La nuit tombait ; l’oiseau dormait (…).
Le printemps embaumait, (…) ;
Les astres rayonnaient, (…).
Moi, je parlais tout bas. (…)
(…)
J’ai dit aux astres d’or : (…) !
Et j’ai dit à vos yeux : (…) !»
À la lumière du Paysage nocturne avec deux hommes de Friedrich, on voit combien les moyens expressifs de l’art de la figuration et ceux de l’art de la parole sont dissemblables : alors que Victor Hugo représente des actions du temps, la peinture représente des formes de l’espace :
 Figure 3 : Caspar David Friedrich, Paysage nocturne avec deux hommes, Huile sur toile, 1830, Hermitage Museum, Saint-Pétersbourg
Figure 3 : Caspar David Friedrich, Paysage nocturne avec deux hommes, Huile sur toile, 1830, Hermitage Museum, Saint-Pétersbourg
La construction poétique de la temporalité au moment du soir prend un autre aspect dans cette ʺidylleʺ léopardienne :
«(…), io mi rammento
Che, or volge l’anno, sovra questo colle
Io venia pien d’angoscia a rimirarti:
E tu pendevi allor su quella selva
Siccome or fai, che tutta la rischiari.»
Se superposent dans ce dernier poème le temps objectif qui s’est écoulé en un an, le présent de l’écriture poétique et l’imparfait de la réminiscence. Le contraste entre ces deux derniers temps est particulièrement mis en relief grâce à l’enjambement entre les vers 4 et 5. Le passage insensible de l’imparfait au présent permet de gommer la distance temporelle et de créer l’illusion d’une conversation avec la lune qui surgit dans l’ici et maintenant de la parole. L’image textuelle divise ce colloque intime en trois temps qui s’unifient en un seul moment parlant, alors qu’une image picturale spatialiserait ce colloque en un cadre muet.
On pourrait définir la fonction poétique de la langue comme la capacité de création, création dans l’imaginaire par le jeu constant d’associations d’images, création dans la langue même par le jeu sur les codes linguistiques.
Paradoxalement, cette poésie descriptive se rapproche de la peinture et parvient même à combler le fossé entre les deux arts, dans la mesure où elle crée un ‘arrêt’ sur image qui se ‘prolonge’ dans le temps de l’écriture. Elle représente le mouvement de la narration dans la fixité propre au tableau. Cette harmonisation du rapport différent de la poésie et de la peinture à l’égard du temps et de sa représentation est indissociable d’un travail sur le signifiant couleur.
« S’io fossi pittore ! che ricca materia al mio pennello!»: le poète attiré par le modèle pictural
Ne faut-il pas en effet considérer comme proprement pictural l’effet de vrai et le plaisir esthétique liés à la disposition des couleurs ? Grâce à ce travail stylistique, la poésie évolue vers la peinture d’impressions :
« E il Sol che all’Ocean fiammeo ricade,
Vario-tinge le nubi, e lascia il mondo
All’atra Notte che muta lo invade.
(…)
S’alzan con l’Ore negre e taciturne
Oscuritate e silenzio profondo. »
Ce poème décrit le passage du coucher du soleil à la descente de la nuit. Les images, vives et intensément colorées, à la grande suggestivité visuelle, tendent à la recherche d’une poésie figurative, de ce que Foscolo appelle « l’arcana armoniosa melodia pittrice ». La métaphore picturale « Vario-tinge » (« Teint en nuances ») montre que la poétique de Foscolo est ‘ut pictura’: elle subit indéniablement l’attraction du modèle pictural. À la lecture des vers qui suivent on serait tenté, au risque de l’anachronisme, de rapprocher de l’impressionnisme cette écriture poétique qui s’exprime en termes picturaux :
« Un coin du ciel est brun, l’autre lutte avec l’ombre,
Et déjà, succédant au couchant rouge et sombre,
Le crépuscule gris meurt sur les coteaux noirs. »
On est déconcerté par le vers hugolien, qui semble véritablement « écrire la peinture ». Alors que pour la génération romantique, le vrai qu’on doit atteindre est une asymptote insaisissable, pour la génération « réaliste » de Flaubert et de Courbet, le vrai est dans les choses, et les choses sont délimitées, finies, enserrées dans le trait. Pour la génération suivante, qui verra éclore à la fois le naturalisme et l’impressionnisme, le trait ou le contour est une illusion de l’esprit, le véritable « réalisme » consiste à saisir les jeux d’échos des lumières et des couleurs. Désormais, être réaliste c’est saisir l’impression.
Chez Victor Hugo, le corps lumineux stimule la verve du poète. Dans la description du soir que l’on vient de considérer, la source lumineuse, obscurcie par l’ombre, crée le « brun », le « rouge sombre » et le « gris ». Ce mélange vif, qui mêle des couleurs ‘à l’huile’ à des teintes plus faibles, est mis sur papier par un trait de plume extrêmement semblable à la touche du pinceau : le soir tend à se dégager comme un tableau. Denis Diderot développe cette fusion entre peinture et poésie, à travers une remarquable métaphore filée dans le Salon de 1767. L’écriture peut-elle se présenter comme une ‘peinture verbale’ à part entière ?
Une « écriture picturale »
Cette expression désignera l’ensemble des détours stylistiques qui tendent à apparier l’écriture poétique aux techniques picturales. À la manière d’un peintre, le poète travaille les contrastes de l’ombre, de la lumière, des couleurs.
Les mots du soir : ombre, lumière, couleurs
Les jeux d’ombres et de lumières
En mariant les dernières lueurs du jour aux premières ombres de la nuit, le poète-peintre représente la beauté douce et calme du monde au moment du soir. Le tableau intitulé Femme devant le coucher du soleil, peint par Friedrich, représente le « sentiment d’étonnement extatique » éprouvé par l’individu, face au spectacle lumineux du monde à l’heure vespérale :
 Figure 4 : Caspar David Friedrich, Femme devant le coucher du soleil, Huile sur toile, 1818, Museum Folkwang, Essen
Figure 4 : Caspar David Friedrich, Femme devant le coucher du soleil, Huile sur toile, 1818, Museum Folkwang, Essen
Ce qui caractérise avant tout la lumière du soir, c’est la splendeur. Le soir après le déluge de Turner montre qu’il y a juste assez de lumière pour faire ressortir et ‘ressentir’ la profondeur de l’ombre :
 Figure 5 : William Turner, Ombre et ténèbres. Le soir du déluge, Huile sur toile, 1843, Volé en 1994 au Kunsthalle Schim, Francfort
Figure 5 : William Turner, Ombre et ténèbres. Le soir du déluge, Huile sur toile, 1843, Volé en 1994 au Kunsthalle Schim, Francfort
Atténuée, voilée par l’ombre, la lumière du soir se dérobe à la clarté brutale et à la chaleur du soleil. C’est bien l’ombre vespérale qui permet de créer un climat tempéré et idéal :
« Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe,
(…)»
L’ombre fraîche du soir n’est pas noire ; elle est traversée d’une lumière diffuse, que filtre par exemple le feuillage d’un bois :
« (…),
Dell’igneo Cintio s’ascose il raggio ;
E all’umid’ombra siedi
Meco dell’ampio faggio.»
Cette image d’un bois baigné du clair-obscur du soir pourrait être illustrée par « Le soir » de Friedrich :
 Figure 6 : Caspar David Friedrich, Le soir, Huile sur toile, Entre 1820 et 1821, Niedersächsisches Landesmuseum, Hanovre
Figure 6 : Caspar David Friedrich, Le soir, Huile sur toile, Entre 1820 et 1821, Niedersächsisches Landesmuseum, Hanovre
Le soir est le moment du bien-être, de la plénitude heureuse. Sa luminosité suscite une impression de bercement dans « L’invitation au voyage » :
« (…)
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.
La « chaude lumière » s’oppose à la froideur des ténèbres du spleen baudelairien. Le soir est précisément partagé entre la chaleur du jour et la froideur de la nuit :
« (Vois) Le Soleil moribond s’endormir sous une arche,
Et, comme un linceul traînant à l’Orient,
Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche. »
Après le soleil couchant, le crépuscule est le moment où le mélange d’ombre et de lumière atteint son équilibre le plus fragile :
« Et déjà, succédant au couchant rouge et sombre,
Le crépuscule gris meurt sur les coteaux noirs. »
«Già tutta l’aria imbruna,
Torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre
Giù da’ colli e da’ tetti,
Al biancheggiar della recente luna.»
Comme l’indique le poème de Leopardi, le ciel crépusculaire est désormais auréolé de la clarté de la lune. Car le crépuscule est l’heure de rencontre des dernières lueurs du jour et de la nuit qui s’éveille. Le tableau de Carus ci-dessous peut donner une idée de la luminosité qui caractérise le ciel crépusculaire :
 Figure 7 : Carl Gustav Carus, Clair de lune à Oybin, Huile sur toile, 1828, Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt
Figure 7 : Carl Gustav Carus, Clair de lune à Oybin, Huile sur toile, 1828, Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt
Ces évocations poétiques du soir révèlent des oppositions de couleurs. Au rouge éclatant du coucher du soleil succède, à l’heure du crépuscule, le bleu des ombres déjà nocturnes. Le soir peut ainsi être perçu comme le moment de l’apogée des contrastes de couleurs. Une couleur résulte du réfléchissement de la lumière solaire par un objet. Voici la définition que Baudelaire en propose :
«Quand le grand foyer descend dans les eaux, de rouges fanfares s’élancent de tous côtés ; une sanglante harmonie éclate à l’horizon, et le vert s’empourpre richement. Mais bientôt de vastes ombres bleues chassent en cadence devant elles la foule des tons orangés et rose tendre qui sont comme l’écho lointain et affaibli de la lumière. Cette grande symphonie du jour, qui est l’éternelle variation de la symphonie d’hier, cette succession de mélodies, où la variété sort toujours de l’infini, cet hymne compliqué s’appelle la couleur. »
Le poète du spleen met les nuances des couleurs en relation étroite avec les notes de musique. Les teintes du soir réalisent dans l’espace de véritables ‘symphonies’ colorées. On ne manquera pas de noter que Baudelaire met l’accent sur quatre couleurs en particulier : le rouge et ses dérivés, le bleu, les « tons orangés » qui ne sont qu’une variante du jaune, et le rose, autant de couleurs ‘essentielles’ dans une « ambiance de soir » :
 Figure 8 : Claude Joseph Vernet, Port maritime dans une ambiance de soir avec le phare, Huile sur toile, 1775, Ancienne Pinacothèque, Munich
Figure 8 : Claude Joseph Vernet, Port maritime dans une ambiance de soir avec le phare, Huile sur toile, 1775, Ancienne Pinacothèque, Munich
Les teintes
Le soir en poésie, c’est avant tout la représentation d’un phénomène réel inscrit dans un cadre particulier. En ce sens, le soir relève du pittoresque. Le premier constat portera sur l’utilisation d’un lexique et de comparants extrêmement conventionnels. À cela, on répondra néanmoins que le soir est lui-même un phénomène répétitif car réglé par les lois de la nature et du cosmos, et limité à une gamme de couleurs restreinte dont le poète est bien forcé de tenir compte s’il veut peindre le réel.
La syntaxe s’efface au profit de la recherche lexicale ; les mots employés relèvent pour la plus grande partie du style sublime. La « palette du style » décline toute une série de couleurs chaudes en évitant souvent de nommer expressément le ‘rouge’. C’est donc à un travail de synonymie que se livre le poète : de là la récurrence du vermeil, d’autant plus exploité qu’il peut être adjectif ou substantif et qu’il désigne à la fois une couleur et une matière :
« Cosi’ non luce mai vermiglio il monte
Cui batte il Sol di sera, (…)»
«Je voyais, comme on dresse au lieu d’une victoire
Un grand arc de triomphe éclatant et vermeil,
À l’endroit où s’était englouti le soleil,
(…) »
« (…), à l’heure où le soleil tombant
Ensanglante le ciel de blessures vermeilles,
(…) »
Intensément vif, plus foncé que l’incarnat, le vermeil possède une vigueur qui s’accorde parfaitement avec l’ardeur vitale. En raison de sa nature à la fois métaphorique et précieuse, le vermeil irradie une aura mystérieuse qui signe son appartenance au vocabulaire poétique. Le rouge romantique, couleur du sang, de la vitalité, de la passion, du pouvoir, confine au baroque par le goût de l’excès ; au classique par la théâtralisation tragique. Le rouge fait toucher les deux extrêmes : l’amour et la mort.
L’image du soleil sanglant ne se développe réellement qu’avec Baudelaire: dans « Les Petites Vieilles », à l’heure du crépuscule, le promeneur parisien voit le ciel devenir de sang à travers ses plaies. La métaphore du sang solaire, qui tantôt ruisselle, tantôt se ‘coagule’, est fondamentale dans Les Fleurs du mal :
« Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige »
Ainsi, une particularité de ces tableaux solaires est d’éveiller une « rêverie poétique » sur la lumière et sa ‘matière’ : non moins présent, le champ lexical du feu se déploie à travers plusieurs métaphores chez Ugo Foscolo :
«Dell’igneo Cintio s’ascose il raggio;
(…) »
L’adjectif « Igneo », qui signifie « de flamme », « enflammé », est la marque d’un langage poétique noble, recherché, propre au néoclassicisme. « Cintio » est une désignation d’Apollon, souvent employé, par métonymie, pour indiquer le soleil. Le soleil est donc de la nature du feu comme le rappelle le couchant flamboyant des « rimembranze » :
«E il Sol che all’Ocean fiammeo ricade,
(…)»
Le pouvoir du soleil est tel, qu’il en vient à concilier des éléments incompatibles, pour aboutir à « une matière mi-liquide, mi-aérienne », une sorte de ‘liquéfaction brumisée’ du feu. Cette rêverie sur des éléments qui ne peuvent a priori coexister explique le succès, en peinture comme en littérature, des soleils couchants maritimes, où le feu semble naître de l’eau :
 Figure 9 : Claude Joseph Vernet, Le Naufrage (Version de Bruges), Huile sur toile, 1759, Groeninge Museum, Bruges
Figure 9 : Claude Joseph Vernet, Le Naufrage (Version de Bruges), Huile sur toile, 1759, Groeninge Museum, Bruges
Le soleil constitue donc une sorte de ‘matière d’alchimiste’, dont la préciosité est dévoilée par la représentation poétique du spectacle solaire ; il permet au poète de donner un sens concret au rêve d’un Absolu poétique, fondé sur l’union de la matière et du monde.
On est alors face au paradoxe poétique « de l’incarnation d’une forme solide par une matière incorporelle » : c’est le vermeil solaire ou l’or auquel le soleil est régulièrement apparié. L’or qui sert de comparant au soleil est en effet lié à l’atmosphère, à la matière gazeuse qui, scientifiquement, compose le soleil. Le soleil couchant et sa lumière dorée poussent à maintes reprises Hugo et Baudelaire à la métaphore de l’or :
« J’ai dit aux astres d’or : Versez le ciel sur elle ! »
« Le soleil, dans les monts où sa clarté s’étale,
Ajuste à son arc d’or sa flèche horizontale ;
(…) »
« – Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or
(…) »
« (…), dans ces soirs d’or où l’on se sent revivre,
(…) »
Lorsqu’on lit la troisième strophe de « L’invitation au voyage » citée plus haut, on peut penser aux tableaux de Salomon Van Ruysdael, peintre néerlandais du XVIIème siècle, réputé pour ses cieux immenses et nuageux qui tamisent avec délicatesse la lumière et la splendeur des soleils couchants :
 Figure 10 : Salomon Van Ruysdael, Paysage de rivière avec un passeur, Huile sur bois, 1650, County Museum of Art, Los Angeles
Figure 10 : Salomon Van Ruysdael, Paysage de rivière avec un passeur, Huile sur bois, 1650, County Museum of Art, Los Angeles
On retrouve dans le comparant de l’or la volonté étudiée préalablement d’alliance d’éléments inconciliables. Ce qui est ‘splendide’ ici, c’est justement la transgression des frontières du possible, qui donne un corps aux visions : des « astres » aux « soirs » d’or, en passant par la métaphore vestimentaire de « L’invitation au voyage », la lumière s’incarne, et dans une matière plus résistante que les soleils liquéfiés rencontrés précédemment. Cependant, les deux tendances ne s’excluent pas : les astres d’or sont en effet liés à la liquidité du ciel dans « Hier au soir ». L’or est bien la couleur par excellence du soleil et des astres, sources de lumière éblouissante, avec quelque chose de vivifiant, de fortifiant que ne possède pas la lumière blanche.
Le blanc est une synthèse additive des lumières de toutes les couleurs. De fait, il peut être considéré comme un ‘absolu’ de la couleur, une couleur immaculée, originelle. Par extension, le blanc en vient à indiquer la pureté :
« Vergine luna, tale
È la vita mortale.»
« Più felice sarei, candida luna. »
La virginité de la lune léopardienne est indissociable de sa candeur. Quant à Hugo, il fait de la lune le symbole d’une sainteté, d’une ‘religion naturelle’ :
« En ce moment le ciel blanchit.
La lune à l’horizon montait, hostie énorme ;
(…) »
Dans cette perspective de religiosité, le choix des couleurs est significatif : aux couleurs violentes, éclatantes, caractéristiques de la passion, Baudelaire préfère les tons pastel :
« Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses,
(…) »
« Un soir fait de rose et de bleu mystique,
(…) »
Ceux-ci sont plus propres à évoquer un sentiment nourri de pureté et de spiritualité. Le rose est un rouge délayé, en général réservé à l’aurore. Avec le bleu, ne renvoient-ils pas, dans l’imaginaire religieux collectif, à la couleur des vêtements de la Vierge et des anges ?
L’azur est un état lumineux du bleu ; il est la couleur du ciel pendant le jour, couleur claire, brillante, répandue dans toutes les directions de l’espace, à l’opposé du bleu profond et sombre qui se diffuse dans le ciel au soir. Ce bleu est une synthèse de l’ombre grandissante de la nuit et de la lumière du jour qui tombe : il est « l’obscurité devenue visible » :
« Già tutta l’aria imbruna,
Torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre
(…) »
Le ciel du « samedi du village » est d’un bleu cerné d’ombres ; il est à l’heure du déclin du jour. Notons les séquences vocaliques en « o » et en « a » qui ne manquent pas dans ces deux vers : ces phonèmes sont ouverts, leurs sonorités ne donnent-t-elles pas l’impression de la vastitude de la nuit qui s’avance, de l’expansion indéterminée des dégradés chromatiques ? L’idée esthétique d’une harmonisation audible des phonèmes apparaît au XIXème siècle, à un moment où les musiciens romantiques parlent de leur art comme d’un système sémiologique expressif : la musique est censée ‘parler’.
La ‘mélodie’ du soir
Extrêmement attaché à l’art du contraste et de l’orchestration des phonèmes, Leopardi ne néglige pas la « polysensualité » du paysage nocturne, jouant sur la complémentarité entre paysage visuel et paysage sonore. Considérons les enchaînements phonétiques qui miment le jeu des nuances chromatiques dans les premiers vers de « La sera del dì di festa » ; la répétition massive de certains phonèmes contrastifs attire l’attention du lecteur :
« Dolce e chiara è la notte e senza vento,
E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
Posa la luna, e di lontan rivela
Serena ogni montagna. (…) »
Leopardi-descripteur relève le défi d’une scène que l’œil peut à peine saisir, et joue avec les sonorités qui permettent de rendre compte de l’immensité spatiale. Ce paysage nocturne fait en effet appel à l’ouïe, aussi bien qu’à la vue de l’esprit. Leopardi tresse les éléments lexicaux selon des associations phonétiques, par allitérations, dont on peut citer un exemple, fondé sur l’insistant vocalisme en « a » et « o ». Les notations auditives, associées à la structure anaphorique en « e », qui possède une résonance extrêmement vaste, permettent un élargissement du champ des perceptions, suggèrent l’immensité du ciel nocturne et de la campagne, faiblement éclairés par la lumière de la lune.
Les allitérations fricatives sourdes en « s » évoquent la douceur, la grâce, la légèreté de ce paysage.
Ce qu’il faut souligner ici, c’est le remarquable accord de la théorie léopardienne de la description avec sa poétique du paysage restreint, caché : Aux yeux de Leopardi, la plus grande poéticité de la description réside dans le raccourci par synesthésie, dans la suggestion synthétique, dont le modèle serait Dante. Si le fait de décrire en quelques vers n’a rien de bien original, il est en revanche très intéressant de noter ces images vagues et « indéfinies » qui ne disent pas tout d’un objet pour mieux laisser travailler l’imagination du lecteur. C’est ce que faisaient, selon Leopardi, les poètes de l’Antiquité.
C’est par un effet de ‘translation’, de passage du visuel au domaine de l’auditif, que le poète cherche des équivalents pour traduire ce que le tableau donne à voir. Les jeux de timbres et de tessitures donnent à entendre les contrastes, comme si le « e », presque muet, confinait aux ténèbres par son silence. L’aperture du « a » et du « o » semble, au contraire, être le « clairon de la pensée », pour reprendre Hugo : leur sonorité habite le texte, comme le noir habite la toile d’un paysage nocturne.
Il y a donc bien une ʺmusicalité de la poésieʺ. Et le silence dont on vient de parler, ne participe-t-il pas « à l’élaboration et à la transcription de la musique » ? Comme pour les notes de musique, chaque durée de silence possède sa marque en littérature ; comme dans le solfège, un silence est un instant pendant lequel le poète ʺn’émet aucun sonʺ : l’enjambement est un procédé de versification qui suggère le silence du poète face à la nature astrale et aux phénomènes célestes, et construit « une sorte d’analogue spatial, sensible, du silence » :
« (…) E quando ti corteggian liete
le nubi estive e i zeffiri sereni,
e quando dal nevoso aere inquïete
tenebre e lunghe all’universo meni
(…) »
Les enjambements entre les vers 3 et 4 et les vers 5 et 6, ainsi que le blanc typographique qui sépare les vers 4 et 5, miment les intermittences du cœur et l’errance visuelle du poète, qui semble peiner à trouver ses mots pour dire ce qu’il voit. Le langage verbal n’est-il pas déceptif ? Foscolo ne traite-t-il pas le soir par un aveu d’impuissance ? Le silence peut être reconduit à une conscience aiguë des difficultés des mots face au réel ; l’écrivain « (…) aborde radicalement le pourquoi du monde dans un comment écrire ».
Dans la sphère de l’ « exprimable », Dubos reconnaît à la peinture un plus grand pouvoir qu’à la poésie, car elle emploie des « signes naturels dont l’énergie ne dépend pas de l’éducation », ou pour le dire autrement elle fait voir « la nature elle-même ». Alors que le langage verbal, qui use de signes « arbitraires et institués », nécessite que le mot éveille l’idée dont il est le signe non naturel, afin de créer un ʺeffet de tableauʺ.
-
« C’est ce qui échappe aux mots que les mots doivent dire »
Le soir, décor de la parole et du silence poétiques
Au soir silencieux correspond le mutisme du poète, qui souvent ne peut que se taire après avoir observé un spectacle naturel. Foscolo décide de composer son silence face au soir. Pourquoi cette décision ? Faut-il entendre que la capacité de l’écriture à exprimer un espace réel en système de signes linguistiques est un leurre ? Le silence n’est jamais explicitement défini en poésie : est-il douloureux ? Angoissé ? Embarrassé ? Recueilli ? Serein ? Il semble malgré tout signifier à chaque fois la confusion des mots par rapport à la vision, les souffrances dissimulées et inexprimables des cœurs et des esprits. Foscolo et bien d’autres poètes font ce choix esthétique de l’écriture du silence et prennent le parti de matérialiser les pauses et les silences dans la description.
Les mots semblent échouer à traduire le visuel, puisqu’ils exigent une continuité, un développement, donc une dimension temporelle, là où le regard donne la sensation de saisir en un seul instant. À un regard fait écho la complexité des phrases, dont le déroulement est impossible à écarter. La description du soir se présente alors comme une exacerbation des difficultés de traduction du visible au lisible. Devant son objet, le poète se réfugie derrière ce que l’on pourrait nommer un « système sémiologique régressif » que constituent les enjambements, les blancs, les tirets, la succession de vers brefs et longs, autant de signes linguistiques qui dénoncent l’impossibilité de la description.
Les signes de la faillite du langage
L’écriture en vers réguliers irrégulièrement répartis
Face à la vertigineuse question du sens de la vie, le berger de Leopardi s’adresse à la lune en alternant les hendécasyllabes avec les heptasyllabes :
« Che fai tu, luna, in ciel ? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.»
Le vers libre trouble la fluidité du poème ainsi que l’élaboration du sens ; il rythme la respiration du discours du berger : celui-ci semble parler de manière saccadée, par pauses imprévues.
L’enjambement
Une pause est un temps indéterminé, relativement bref, qui sépare deux moments de diction, et l’enjambement est une matérialisation de la pause dans l’écriture, chargée de visualiser cette pause typographiquement :
« Dietro Apennino od Alpe, o del Tirreno
Nell’infinito seno
Scende la luna; e si scolora il mondo;
Spariscon l’ombre, ed una
Oscurità la valle e il mondo imbruna;
(…)
Tal si dilegua, e tale
Lascia l’età mortale
La giovinezza. (…) »
Le double effet de déstructuration et d’allongement que produisent les enjambements est particulièrement perceptible entre les vers 13 et 14, où l’enjambement est accentué par un rejet. Ce procédé métrique peut être considéré comme le support expressif d’un affect. Dans « Il tramonto della luna », il est la marque des limites d’un langage impuissant à signifier l’intensité de l’angoisse de l’homme, qui prend pleinement conscience de sa propre finitude. Foscolo lui-même a longuement commenté l’importance de la typographie, et notamment du tiret, ponctuation qui imiterait la spontanéité et l’émotivité.
Le tiret
Le tiret mime avant tout le passage de la constatation à la réflexion :
« Ma qual per l’aere di velo a foggia
Nube si stende? – ah certo
Vicina è a noi la pioggia.»
Mais le silence lié à ce passage peut être interprété comme une ellipse à part entière, ou comme l’attitude momentanée et volontaire du poète qui refuse de parler.
Au-delà de l’interruption du discours, n’est-ce pas la valeur du non-dit qui est mise en avant ? L’énonciation suspendue, le lecteur doit faire appel à sa capacité de se représenter la scène au-delà du silence de l’écriture. À cet égard, Georges Molinié fait remarquer que, paradoxalement, le renoncement descriptif, feint ou réel, constitue un appel à la collaboration du lecteur, qui renforce ainsi sa participation au texte : en effet, invité à devenir « co-auteur » de l’œuvre, le lecteur éprouve « comme la palpitation et le trouble » de l’auteur, « confronté aux difficultés techniques de l’expression » :
« Je vois se dérouler des rivages heureux
Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone ;
Une île paresseuse où la nature donne
Des arbres singuliers et des fruits savoureux ;
(…) »
Le ‘blanc silencieux’ entre les vers 4 et 5 permet à l’imagination du lecteur de déployer la vision, et de créer une mise en relief : le blanc ne constitue-t-il pas en effet une ‘délimitation graphique’ de l’île évoquée au vers 5, elle-même ‘géographiquement isolée’ car préservée de la civilisation ? Cette île est le lieu utopique par excellence, le symbole d’un âge d’or perdu ; elle incarne aussi toutes les aspirations de l’imaginaire. Elle illustre enfin, comme le montrent les vers 5 et 6, le mythe de la terre-mère à l’inépuisable générosité.
Le blanc est une impossibilité discursive. Dans les vers qui suivent, le blanc concrétise le trouble ressenti par le poète, face à l’absence de termes susceptibles d’exprimer son sentiment amoureux :
Que se passait-il dans nos âmes ?
Amour ! Amour !
Comme un ange qui se dévoile,
Tu me regardais, dans ma nuit,
(…) »
‘Que se passe-t-il’ entre les vers 4 et 5 ? Que se passe-t-il dans les « âmes » des amants ? L’intensité de l’émotion est telle que le poète ne parvient pas à restituer sa pensée avec exactitude. Ce qu’il importe de préciser également ici, c’est le rôle joué par la ponctuation et la répétition. Les points d’interrogation, les points d’exclamation, la répétition d’ « Amour » renforcent l’impression de désarroi qui émane de ces vers. L’exemple de « Caeruleum mare » montre que les points d’exclamation ne manquent pas de produire un certain suspense dramatique :
« On entrevoit le firmament !
Le firmament ! où les faux sages
Cherchent comme nous des conseils ! »
La parole demeure irrémédiablement suspendue. Pourquoi chercher un mot pour dire ce que l’on ne peut dire ? Le silence est davantage apte que le mot à exprimer avec justesse les sentiments éprouvés, dans la mesure où sa soudaineté et son immédiateté surmontent la médiation par le langage, source de méprises.
Moins qu’un renoncement, les procédés poétiques que l’on vient de mentionner sont des réponses au problème de la description. L’indétermination, les silences ou les obstacles sont autant de conditions nécessaires à la stimulation de l’imagination. Ce qui se donne à voir dans l’observation silencieuse, c’est une dimension visuelle qui doit être reconduite à un besoin de mots manquants, auquel la poésie essaie de répondre. Ainsi, avant même sa mise en discours, le soir semble appeler le langage poétique. Puisque ce sont l’infinité de l’espace cosmologique et la ligne d’horizon qui le définissent, le soir est, précisément, marqué du sceau de l’ « indéfini ». Les mots visent justement à ‘définir’ par des images verbales ce qui échappe au regard. De fait, le soir oscille entre présence et absence ; le soir perçu s’accompagne toujours du soir imaginaire. La parole poétique s’efforce de réparer une perte « en retrouvant (ou en déclarant retrouvé) le ‘temps perdu’, c’est-à-dire le temps où la vérité de la sensation n’avait pas été reconnue. » Le soir lance alors un défi à l’écriture poétique, dont la difficulté se double désormais d’un problème non seulement de description et de recomposition, mais aussi de ‘composition’.
De la ʺdécompositionʺ du soir naturel à la ʺcompositionʺ du soir poétique
Pour décrire les instants vespéraux de clair-obscur, les poètes font donc des choix d’écriture. Ils ‘décomposent’ le soir et ‘sélectionnent’ les moments à ʺpeindreʺ par les mots. Comment procéder alors, pour qu’en dépit de ses limites, le langage verbal devienne, plus qu’un facteur de recomposition, l’Élément de ‘composition poétique du soir’ ?
Ugo Foscolo met progressivement l’accent sur la nécessité d’un processus ‘sélectif’ au cœur de la mimèsis. Dans sa lettre au peintre François-Xavier Fabre, probablement écrite en 1814, Foscolo expose son idéal formel : seul l’équilibre des verbes, des adjectifs et des substantifs peuvent donner l’illusion d’un tableau. La création du ‘soir poétique’ est donc fondée sur une recomposition de détails choisis, réalisée par le poète. Le ‘choix’ est la condition de la création. Dans cette perspective, penchons-nous sur un type de choix :
« Già tutta l’aria imbruna,
Torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre
Giù da’ colli e da’ tetti,
Al biancheggiar della recente luna.»
Tout comme le peintre qui cadre, et qui ne peut donc être mimétique à la lettre, Leopardi choisit des coloris intenses et aquarellés pour mettre en valeur, plutôt que des contours réguliers, les masses, les variations d’intensité de l’ombre et de la lumière, et surtout, l’opposition chromatique du blanc de la lune et du noir de l’ombre grâce à la rime entre « imbruna » et « luna ». Le choix du moment et du détail s’impose ; le choix de Leopardi est de représenter la nature, dans ce qu’elle a de vague, d’incertain.
Ce choix est un écart, un détournement. Ce détournement n’est pas d’ordre sémantique, mais poétique. Paradoxalement, l’objectif est toujours de faire voir le soir. Le problème n’est cependant pas de représenter les contours du réel comme un tableau pour égaler la figuration picturale, mais de peindre les ‘effets’ que produit la nature sur l’esprit de l’homme. Les choix et les procédés de construction poétique qui en découlent, montrent qu’une entité particulière, l’esprit du poète, vient s’ajouter à la topique traditionnelle de l’ « ut pictura poesis ».
Surgit d’entrée de jeu la notion clef d’ « imagination créatrice ». La représentation mentale précède la représentation artistique, picturale ou langagière. Dans la tradition matérialiste, à laquelle le sensualisme appartient, l’imagination est le produit des sensations charnelles. Une sensation est une « attention passive » ; les sensations conduisent à l’imagination : la mémoire enregistre des souvenirs sensoriels liés à des expériences du réel ; les associations entre ces souvenirs créent un langage nouveau, décuplent les conditions de « l’imagination ». L’explication de Voltaire donne une idée claire de ce processus de l’esprit. Notons que, selon cette conception, imaginer présuppose qu’on ait tout d’abord éprouvé une sensation et, en second lieu, qu’on l’ait mémorisée.
L’imagination répond à une volonté intérieure d’agencement, de réorganisation des sensations. L’impression d’unité qui fonde « Harmonie du soir » repose essentiellement sur des correspondances entre les diverses sensations :
« Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir ;
(…) »
Cette poétique des correspondances est le fruit de l’imagination, de l’image mentale qui permet de voir le soir d’une certaine manière. Le tournoiement de la valse produit un jeu d’échanges, un « langoureux vertige » entre les sensations olfactives : « parfums » au vers 3, « fleur » et « encensoir » au vers 5 ; auditives : « Les sons » au vers 3, « violon » aux vers 6 et 9, « Valse mélancolique » au vers 7 ; et visuelles, qui se traduisent par des notations de mouvement telles que le balancement de la fleur dans la première strophe ou le tournoiement de la valse aux vers 4 et 7. Cette description est bel et bien une composition, une ‘symphonie’ de sensations. L’écriture de Baudelaire pourrait être qualifiée de « traversante », dans la mesure où elle met en circulation des sensations de nature différente, sans que soit proposée une exacte correspondance entre elles. L’atmosphère du soir suggère une dimension spirituelle; elle crée de surcroît un effet incantatoire, la répétition des mêmes vers parvient à rendre perceptible non seulement la sensualité envoûtante du soir, mais l’état d’âme du poète. Le soir révèle en effet à Baudelaire ses propres sentiments ; la valse, « mélancolique », lui fait prendre conscience de sa tristesse. Le poète projette son tourment et sa douleur sur le soir ; sa souffrance apparaît dans la comparaison subjective du violon qui « frémit comme un cœur qu’on afflige » et dans la métaphore du soleil « noyé dans son sang qui se fige ». Baudelaire ne fait-il pas l’expérience du ‘mot-miroir’ ?
En se réappropriant l’ « ut pictura poesis », l’imagination n’introduit-elle pas la sensibilité émotionnelle du poète ?




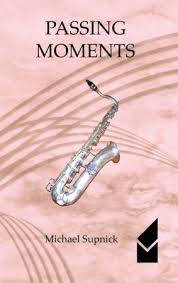 Connaissez-vous la Gennet Record Company, Richmond, Indiana, Bix Beiderbecke, les flapper girls, le lindy hop, la shim sham ? Non ?! Ce sont pourtant les lieux, les personnages et les danses qui ont accompagné la légende du Jazz. Et c’est cette histoire passionnante que nous dévoile en italien Michael Supnick dans ce roman surprenant dont le titre, tiré sans doute d’une pièce de jazz, est déjà tout un programme : Passing moments. Tout commence par le plus banal des hasards : l’acquisition d’un vieux saxophone acheté sur Internet. Mais l’année de sa fabrication -1912- intrigue ce jazzman accompli, américain de naissance et italien d’adoption, qui a plus de 70 enregistrements à son compteur. Se pourrait-il que ce saxophone ait été le témoin de l’histoire du jazz ? Il n’en fallait pas plus pour allumer l’imagination de Supnick qui aussitôt s’enquiert du premier propriétaire de l’instrument. Les quelques éléments glanés lui suffisent pour brosser la trame d’une histoire qui se révèle par petites touches, comme un secret de famille. Et qui pour lever ce secret sinon un jeune garçon de huit ans dont la curiosité l’amène à découvrir dans le grenier de la maison un vieille malle obstinément fermée. Que contient-elle et pourquoi la valise à ses côtes, remplie de robes de bal des années trente disparaît-elle aussitôt que Jimmy, c’est le nom du petit garçon, en parle à sa mère ? Nous sommes le 29 mars 1967 , à Richmond , Indiana, au cœur de la Bible Belt mais qui fut aussi un temps le cœur vibrant des Roaring Twenties : les années 20 américaines. Pour la raconter Supnick construira deux récits en parallèle : le premier est celle de l’histoire du jazz qui va de 1923 à la fin des années 60 ; le second part justement de cette période, celle de la redécouverte, jusqu’ à sa reconnaissance dans les années 80. Cette trame alternera et finira par se confondre comme les branches du caducée , le 13 mai 1980 dans un chapitre conclusif qui s’intitule justement « La réhabilitation ». Car cette entreprise est bien celle de la réhabilitation de la mémoire occultée où Jimmy découvrira la véritable histoire de son grand-père paternel, Boogie Windham, jazzman à ses heures, mais surtout de son grand oncle Windy, petit génie du saxophone et propriétaire de l’instrument. C’est à travers lui, sa vie, ses espoirs mais aussi ses déconvenues que le narrateur va nous faire découvrir le jazz. Car Windy serait ce qu’on pourrait appeler « un petit maître » ; il aura joué avec les plus grands sans toutefois obtenir son moment de gloire ; moment qui lui sera volé… par un train dont le sifflet s’invite au beau milieu de son solo sur le point d’être gravé. Car le mythique studio d’enregistrement de Richmond se trouvait tout près de la gare de train, (directement connecté avec la Nouvelle Orléans par où remontaient le contingent de jazzmen noirs invités à se faire voir ailleurs par le nouveau maire d’alors). Et les prises d’enregistrement étaient calculées en fonction des horaires des trains.
Connaissez-vous la Gennet Record Company, Richmond, Indiana, Bix Beiderbecke, les flapper girls, le lindy hop, la shim sham ? Non ?! Ce sont pourtant les lieux, les personnages et les danses qui ont accompagné la légende du Jazz. Et c’est cette histoire passionnante que nous dévoile en italien Michael Supnick dans ce roman surprenant dont le titre, tiré sans doute d’une pièce de jazz, est déjà tout un programme : Passing moments. Tout commence par le plus banal des hasards : l’acquisition d’un vieux saxophone acheté sur Internet. Mais l’année de sa fabrication -1912- intrigue ce jazzman accompli, américain de naissance et italien d’adoption, qui a plus de 70 enregistrements à son compteur. Se pourrait-il que ce saxophone ait été le témoin de l’histoire du jazz ? Il n’en fallait pas plus pour allumer l’imagination de Supnick qui aussitôt s’enquiert du premier propriétaire de l’instrument. Les quelques éléments glanés lui suffisent pour brosser la trame d’une histoire qui se révèle par petites touches, comme un secret de famille. Et qui pour lever ce secret sinon un jeune garçon de huit ans dont la curiosité l’amène à découvrir dans le grenier de la maison un vieille malle obstinément fermée. Que contient-elle et pourquoi la valise à ses côtes, remplie de robes de bal des années trente disparaît-elle aussitôt que Jimmy, c’est le nom du petit garçon, en parle à sa mère ? Nous sommes le 29 mars 1967 , à Richmond , Indiana, au cœur de la Bible Belt mais qui fut aussi un temps le cœur vibrant des Roaring Twenties : les années 20 américaines. Pour la raconter Supnick construira deux récits en parallèle : le premier est celle de l’histoire du jazz qui va de 1923 à la fin des années 60 ; le second part justement de cette période, celle de la redécouverte, jusqu’ à sa reconnaissance dans les années 80. Cette trame alternera et finira par se confondre comme les branches du caducée , le 13 mai 1980 dans un chapitre conclusif qui s’intitule justement « La réhabilitation ». Car cette entreprise est bien celle de la réhabilitation de la mémoire occultée où Jimmy découvrira la véritable histoire de son grand-père paternel, Boogie Windham, jazzman à ses heures, mais surtout de son grand oncle Windy, petit génie du saxophone et propriétaire de l’instrument. C’est à travers lui, sa vie, ses espoirs mais aussi ses déconvenues que le narrateur va nous faire découvrir le jazz. Car Windy serait ce qu’on pourrait appeler « un petit maître » ; il aura joué avec les plus grands sans toutefois obtenir son moment de gloire ; moment qui lui sera volé… par un train dont le sifflet s’invite au beau milieu de son solo sur le point d’être gravé. Car le mythique studio d’enregistrement de Richmond se trouvait tout près de la gare de train, (directement connecté avec la Nouvelle Orléans par où remontaient le contingent de jazzmen noirs invités à se faire voir ailleurs par le nouveau maire d’alors). Et les prises d’enregistrement étaient calculées en fonction des horaires des trains.
