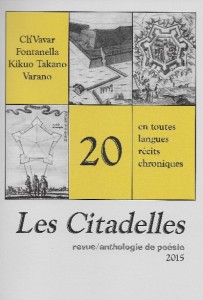Jean-Charles Vegliante

Nous partirons de cet état de fait : tout le monde parle désormais de la traduction, au sens plus ou moins extensible, et presque tout le monde traduit (aussi bien de langues proches, sans nécessité de les avoir étudiées, que de langues éloignées, pour lesquelles on dispose soit de versions ancillaires, soit d’informateurs variés plus ou moins fiables, proches, vivants ou électroniques). Une fois surmonté l’obstacle pour ainsi dire technique, autrefois principal, reste apparemment le talent, sinon le “génie” du traducteur – bien souvent une traductrice, d’ailleurs, aujourd’hui. Les maisons d’édition, depuis quelques décennies, privilégient en général ce talent plutôt que d’avoir recours aux anciens spécialistes et surtout aux professeurs des langues concernées, trop exigeants et responsables il est vrai par le passé de quelques « laides fidèles » qui ont pu à juste titre les échauder. Il y a donc à la fois une conjoncture favorable – avec une évidente amélioration de la qualité des traductions courantes – et une certaine démission devant des textes d’arrivée difficiles, un peu à contre-courant des tendances littéraires du moment, échappant aux cadres historiques et aux canons de la mode. Pour simplifier : ni « classiques » méconnus à faire revivre, souvent à moindre coût, ni possibles « découvertes » à insérer dans quelque rituelle rentrée littéraire de l’année. Enfin, et cela n’est pas anodin, peu propices à l’échange de bons procédés entre qui traduit et qui est traduit, ainsi qu’entre les éditeurs des uns et des autres (le traditionnel renvoi d’ascenseur). Un seul exemple, que je connais bien, hélas, des deux côtés des Alpes : le poète méridional Lorenzo Calogero, un des maîtres reconnus d’Amelia Rosselli, trop tôt disparu. Un choix de lui, déjà maquetté et bon à tirer, est disponible dans notre site CIRCE de Paris 3.
Pour essayer – vainement, peut-être – de coordonner les réflexions en cours autour de la traduction pour le moins littéraire, voire ne concernant que les langues relativement proches que sont en gros les langues de l’Europe (pardon aux langues non indo-européennes et aux langues minorées qui se sentiront exclues), je propose d’aborder la vaste question du traduire à partir d’un accès limité et apparemment indirect qui serait celui de la trace laissée par le fait traductif ou l’idée même du traductif dans un texte donné, que j’ai proposé jadis d’appeler effet-traduction. Cette trace est visible sans grand effort dans les productions de scripteurs bilingues par choix ou par nécessité – “cosmopolites”, comme on disait autrefois, ou déplacés de la langue plus récents – ainsi que tous les degrés de gradation entre les uns et les autres. Les œuvres traduites de quelque résonance influencent évidemment leur langue, y important parfois un « style de traduction » (G. Raboni). Pour ce qui est du domaine italien, ou italique, une thèse récente soutenue en français mais publiée en italien[1] serait là pour fournir d’abondants exemples. Est-il raisonnable d’essayer d’unifier – sans uniformiser – quelques points de départ dans une réflexion concernant un domaine à la fois aussi varié, étendu, ancien mais récemment réorienté autour de la traductologie comme théorie se voulant autonome ? Je pense que oui, ne serait-ce que pour parvenir à une vraie discussion susceptible de passer outre les querelles de territoire et d’exclusions dogmatiques ; ainsi que les crispations ou le « narcissisme des petites différences » : autre face, au fond, de la croyance au fameux “génie” (forcément solitaire) évoqué plus haut. Par expérience, il me semble qu’une telle base d’accord minimal est possible, ne serait-ce que parce que la traduction collective (où tout est effectivement élaboré et produit ensemble), ou encore collective-participative (lorsque la voix de l’auteur peut entrer aussi en ligne de compte), est possible. Là encore, il se trouve que quelques exemples sont disponibles, aisés d’accès, aussi bien pour la poésie de Calogero mentionnée ci-dessus que pour un large choix de la nouvelle poésie italienne (et aussi italophone, ou minorée) vivante aujourd’hui, de Zanzotto à Mario Benedetti, et de sa pensée du paysage singulière à la vaste thématique de la disparition[2].
L’effet-traduction, comme certains « effets » mieux illustrés en littérature (effet de réel, selon Riffaterre et Barthes, pour n’en rappeler qu’un) est évidemment tout interne au discours qui le porte. On néglige ici les reflets induits par les critiques externes et la réception. Il résulte d’un usage particulier des mots, au sein du message global sur lequel repose le caractère littéraire même du discours en question. Néanmoins, il produit sur nous l’effet, très précisément, de renvoyer d’emblée directement à du différent, à de l’autre : non seulement à un « double fond » de nouvelle signifiance, ainsi que tout texte littéraire devrait le faire, mais plus radicalement à une autre dimension linguistique. L’effet-traduction, en ce sens, révèle la présence de l’altérité dans l’identique. Il affecte en effet tous les niveaux de la langue – à commencer par ses structures de surface les plus apparentes – et il traverse ou, si l’on peut dire, dépasse le monosystème de chaque langue concernée : la langue d’origine, qui révèle dans la traduction des potentialités latentes voire invisibles au regard monolingue, et bien sûr la langue de destination qui est poussée jusque dans ses extrêmes, y compris connotatifs, « décentrée » dans l’acception donnée à cette métaphore par Meschonnic. On en dira autant du texte original et du texte de destination produit, qui participent d’ailleurs à l’extension-construction infinie de leurs langues respectives ; d’où l’apport du traduire comme exégèse à la compréhension des textes et à la critique littéraire en général[3]. La traduction, seule de son espèce, est d’un même mouvement hyper-lecture et écriture créative d’un texte ; ce dernier est à la fois contraint (évidemment par l’original, mais aussi par l’horizon de celui-ci) et nouveau pleinement, à juste titre (donc avec une autonomie relative, y compris sous un horizon différent, et en mouvement constant par son acte même[4]), autrement dit libre, au même titre que tout texte littéraire. Autre et identique, encore une fois. De ce point de vue, le texte traduit déçoit, défait – à l’inverse des éventuels effets de réel – ou en tous cas compromet toute illusion possible de « nature », sans devenir jamais pour autant clos sur lui-même et auto-suffisant. Voilà le premier sens de la dimension tierce, supplémentaire, du titre de cet exposé. J’y reviendrai, car la « nature » n’a peut-être pas dit son dernier « mot ».
Mais il faut aller plus loin. Déjà au départ production seconde, la traduction décroche visiblement le texte des référents habituels, donnés pour acquis, quel que soit leur degré de (feinte) « réalité ». C’est pourquoi, spéculairement, un travail sur la poésie dite réaliste (à tout le moins italienne) m’a semblé intéressant, non par hasard en parallèle à des analyses, et à des illusions hâtives, ayant porté naguère sur la littérature transnationale liée aux phénomènes migratoires des dernières décennies (voir n. 1 supra). Sur un plan plus vaste et général, des écrivains bi- ou plurilingues (de Beckett à Meneghello à Amelia Rosselli déjà mentionnée, à Emilio Villa) ne nous ont pas attendu pour tirer parti de l’effet-traduction dans leurs propres œuvres. Ainsi, Ungaretti dès les années Vingt du siècle dernier faisait se superposer et s’échanger, à la lettre, aura “brise” et urne “urna”, entre ses deux langues du cœur, français et italien. Ce décrochage du référent (et donc de l’illusion référentielle), si cultivé par ailleurs dans une certaine récente littérature “nouvelle” – même si l’on est en droit de comprendre le célèbre « écrire, verbe intransitif » de Barthes (1970) comme une blague –, recouvre deux phénomènes distincts, mais qui semblent devoir in fine se rejoindre :
un manque et une perte chez l’émigré, qui, adulte, se retrouve non seulement (en général) déclassé, mais littéralement in-fans ;
et un surplus, un effet (cette fois, de style) recherché, enrichi par l’intertexte translinguistique, chez le créateur affranchi de la syntaxe ordinaire, parfois jusqu’à l’illusion d’une « subversion de la langue » ; où la subversion a bon dos, mais ce serait un autre problème. Quoi qu’il en soit, chez un poète tel qu’Ungaretti, à la fois émigré et créateur translinguistique, la brise (aura) est effectivement au delà de l’image une urne renvoyant à ses chers disparus et à l’archi-texte commun occidental, diffus et mouvant de Pétrarque à Jules Laforgue (« Mon cœur est une urne » … etc.).
S’ils peuvent se rejoindre, ces deux phénomènes peuvent aussi se moduler, de façon positive (enrichissement, débord) ou en négatif (malaise de l’appartenance), l’un et l’autre. Jusqu’à l’excès : glossolalie et langues inventées, là ; anomie et perte du lien aux références, ici. Un autre poète : « Est-ce qu’ici est encore loin ? » (Thierry Metz, L’homme qui penche, 1997), comme à dire que l’on est de toute façon à côté d’un fonctionnement pacifié de la langue, selon une analyse traditionnelle de celle-ci. Son ferme sol se dérobe. Bien loin de créer “spontanément” (ne dit-on pas “langue naturelle” ?) le lien « nécessaire » entre signifiant et signifié qui renvoie à un référent (Benveniste), le locuteur – ou l’écrivain – décentré semble aller à la pêche de mots appropriés, plus ou moins ambigus, mystérieux, pour exprimer ce qu’il aurait à exprimer ; ce n’est qu’en un deuxième temps qu’il s’efforce, pour être compris, de les introduire dans un système singulier, renouvelé lui-même par cette sorte de traduction primaire, fondamentale. Thierry Metz encore :
[…] il faut extraire les mots de là où ils sont. Puis les mettre en langue.
C’est pourquoi j’ai cru bon d’insister plus d’une fois hélas sur l’appartenance autant (au moins autant) que sur la compétence langagière allant de soi[5]. Mais ici, l’expression « mettre en langue », et non utiliser une langue préexistante idéalement, réunit – ainsi que nous le pressentions – le créateur prétendument élitiste et l’immigré soumis au dispatrio (Meneghello). Beau mot du moyen français : dispers. Pour l’un comme pour l’autre, il existe forcément une distance, voire une double défiance vis-à-vis de la langue commune, le passe-partout de la doxa : on sait intimement, douloureusement parfois, son inadéquation, et aussi sa non-innocence (non par hasard, Ungaretti cherchait ailleurs un « pays innocent »). Beau mot de la langue allemande : Grund (Grundlage). Il n’y a pas d’autonomie de la sphère culturelle, dont on sent bien confusément qu’elle est tenue et gérée par les « héritiers » de toujours, de bourdieusienne mémoire. Et l’on est d’autant plus porté à l’utiliser, cette langue conquise, gratuitement parfois, de façon ludique, aussi pour ajouter (contre son usage marchand) de la beauté au monde (Philippe Denis : « Non pas une parole, / pour rien, / nous sommes venus / avec notre langue d’étrangers ») ; d’où les jeux de mots bien connus des exilés (voir l’humour juif), du névrosé (et de l’analyste), du prisonnier (y compris en conditions extrêmes, comme Primo Levi). À titre ici de simples illustrations :
– le premier contact avec le nouveau pays est souvent placé sous le signe de la (fausse) familiarité, à la fois réconfortante et dérisoire (le Maghrébin qui lit Bagagès sur le mur de la gare, l’Italien du sud qui entend crier “Bagaches ! en arrivant à Charleroi, et feint de s’offenser alors que son compatriote rit amèrement devant l’enseigne “Che-miserie moderne”)…
– l’humour décalé, à tout le moins non aligné, d’un écrivain peu conventionnel tel que Michaux : « D’un continent on s’évade. De l’espèce, non » (1974) ;
– le jeu langagier à la Perec – en l’occurrence, un palindrome bilingue – chez un survivant de la déportation : « In Arts it is repose to life : È filo teso per siti strani » (Primo Levi “Cuore vorticoso”, in Lilit e altri racconti, 1981)[6].
Abordée sous l’angle de son effet interne, la traduction oblige donc à accepter le paradoxe du « pleinement linguistique », affectant tous les niveaux de l’analyse en même temps, et du « non-linguistique » impensé, latent (pré-, post-, infra-linguistique par allusion à l’approche novatrice de Gianfranco Contini au travail de Pascoli, en 1955), voire d’un regard esthétique plus vaste encore, relevant d’autres types d’expression (spatiale, musicale, de formes plastiques etc.) que sa destination en un autre code (selon la « transmutation » générale dont parlait déjà Jakobson) permet ou exige. Les « intraduisibles » dont s’est occupée (entre autres) Barbara Cassin ne seraient rien d’autre que des discours jouant à plein sur tous ces tableaux, et demandant pour cela même d’être indéfiniment retraduits, leurs destinations étant censément multiples. Des termes, des expressions ou phrases, des textes que l’on ne cesse pas de reprendre en mains et de retraduire seraient, de par leur épaisseur de sens même, infiniment destinés à être traduits de nouveau. Ils « demandent » en somme (le verbe est celui qu’utilisait Walter Benjamin) plusieurs traductions, plusieurs destinations, que leurs différences enrichissent et qui font à leur tour signe, en vue d’ultérieures lectures, récritures, traductions. Ils seront dits, en général, des « classiques ». Très concrètement, dans le domaine que je connais le moins mal (entre deux langues proches), ce travail va consister à rechercher le “même” par des moyens évidemment différents, mais aussi à faire résonner (dans un texte), en les acceptant pleinement, les divergents “gui” ou “cerf-volant”, certes à distance des – si différents ! – vischio et aquilone, bien propres à désespérer l’étudiant d’italien en quête d’une transparence totale. Il s’agit plutôt de suggérer, de faire sentir autrement (une fois de plus) les valences particulières, mortifère pour l’un (mais “glu” a bien conditionné, dans l’histoire de la langue, le signifiant gui) et fabuleux pour l’autre (par chance, le cerf-volant est aussi un insecte aux mandibules extraordinaires). La langue-culture française garde d’ailleurs lointainement le souvenir sacré des rituels druidiques pour le premier, littéraire des méditations plus récentes de R. Caillois pour le second. Mais, de proche en proche, je voudrais suggérer que cette question est plus générale et touche à strictement parler tous les signes linguistiques, si le regard ne s’élève pas au delà du signe en soi, jusqu’à faire fantasmer la chimère de deux systèmes isomorphes parfaitement correspondants signe à signe (le Quijote de Borges, la « copie à la vitre » de Chateaubriand, le hobby de Jiri Fried, l’illusion du débutant). Ce qui, en bonne logique, ne se peut. C’est donc en changeant tout, en déplaçant les formes de surface, si nécessaire, que la fidélité textuelle peut se transmettre dans l’autre système, lequel devient au sens propre destinataire. Chez Pascoli, puisque c’est de deux mots-thèmes de son œuvre que je suis parti, il s’agit de restituer avant tout la singulière vibration – frêle et invincible – dont ils s’entourent poétiquement, à savoir aussi dans la matérialité du texte qui les contient, sa subtilité métrique, etc.
Regard esthétique vaste, dimension autre, matérialité, vibration… voilà ce par quoi j’aimerais finir, tout à fait provisoirement s’entend, bien sûr. Or, tout le monde s’accorde à dire – comme je l’ai fait ci-dessus – que le texte littéraire doit suggérer, faire sentir, rendre présent ce qui justement lui échappe (l’objet, le monde, le réel). Mallarmé : « Je dis : une fleur ! » etc… Presque tout le monde donne, en ces domaines, une place considérable au corps (ou “corps”, selon qu’on est, là comme ailleurs, « puissant ou misérable » vis-à-vis de la bonne distance), du côté de la création autant que pour la réception (ou mieux désormais, consommation). On parlera en effet de rythmes corporels, de rythme du souffle, de la marche, des battements du cœur, et ainsi de suite, sans besoin d’ajouter d’autres viscères également convoqués. Or, puisqu’il s’agit ici de textes, il serait paradoxal d’oublier que la langue, a fortiori la parole, dans sa dimension orale et son apparence transcrite, comporte bien toujours un versant réel, physique, matériel si l’on veut : on l’entend, le voit par écrit, on peut en suivre voire en accompagner les cadences, etc. On en perçoit, pourrait-on proposer de dire, une manifestation globale avant toute analyse, un holo-signe certes largement conventionnel mais plus proche de la matérialité de ses référents et du corps qui le reçoit ou le produit – y compris à l’instant où je saisis ces lignes sur mon clavier. Un cas particulier en serait le texte enjolivé, manuscrit, disposé en calligramme, mis en cases ou en bulles, voire représenté par la peinture (les cartouches, les glyphes figuratifs des Aztèques) ; ou encore le texte déclamé, dit et entendu, associé à une musique, voire chanté ; ou à la limite le discours mentalement écrit, transcrit, par la minorité dite des « ticket tapers » (mais curieusement, Barthes a pu oser un jour « Je vois le langage », 1975), comme re-matérialisé dans l’image cérébrale que nous en formons à l’instant. Dans le cas le plus général, il y aurait donc, marginalement à côté de la double articulation de la langue humaine une sorte de troisième dimension qui serait celle de ses manifestations et sensations corporelles produites et induites. Pris par l’autre bout, Sylvie Kandé s’en approche peut-être : « du geste qui ne s’entend ni ne s’écrit / n’est-il pas juste de dire qu’il est / pensée qui s’effile dans l’air / propos qui cogne le vide / ombre portée du néant » (Brève de main)[7] ? Ou la nature, en effet…
Cette troisième articulation, si les purs linguistes me passent cette métaphore, bien entendu elle aussi culturelle en dépit de son attache préservée à la matérialité du monde physique, ne serait pas – contrairement aux deux autres – une exclusivité du langage humain. De récents acquis de l’éthologie montrent la complexité du système de signaux très divers mis en œuvre par d’autres êtres vivants, capables eux aussi d’organiser culturellement un certain nombre de messages et de comportements fondamentaux. La productivité des signaux – avec ou sans les signes linguistiques traditionnellement attachés à la langue humaine – n’est plus à démontrer, ne serait-ce que dans les progrès déjà anciens des études de gestique et de la communication non verbale en général. Approfondir ces approches serait précieux pour nous aider à comprendre la possibilité du lien extrêmement fort entre langue et monde naturel : lien qui fait, en premier lieu, que continue d’agir efficacement l’effet de réel dans le texte (avec ses illusions), et plus largement que la rhétorique – y compris dans assemblées ou tribunaux – soit toujours aussi puissante. (Sans être trivial, je me demande pourquoi l’effet de réel peut, sans cela, continuer à retenir le lecteur naïf une fois dévoilé comme artifice). La littérature, et la poésie en tout cas, fait bien sûr un usage privilégié, dans la « fonction poétique » particulièrement, de cette capacité à convoquer un certain nombre d’isotopies assez puissantes pour rester liées au monde (commun) des références, dont les plus directement agissantes seraient celles de cosmos, anthropos et logos – avec, pour cette dernière, le rôle éminent de la traduction –, que l’on peut supposer universelles. On est là, de diverses façons mais avec des phénomènes liés au corps en particulier (par exemple à travers le rythme, exprimé conventionnellement par le mètre), à l’intersection de l’arbitraire, de la convention, et de la nature : les antiques notions de phùsis, thésis et aussi enérgeia y concourent ensemble. Naturel apparent de l’effet, abstrait du signe, réunis pour donner tous deux sa force aux constructions de mots. Mot comme manifestation visible, concrète, de la galaxie sémantique et expressive appelée ailleurs lexème. Mot comme anneau de conjonction entre monde et image mentale, attache puissante du texte à une réalité. Que celle-ci ne soit pas la réalité (ni la vérité), c’est une évidence. Comme le texte de destination (traduit) n’est pas le texte original. L’essentiel, pourtant, peut encore être transmis si la dimension supplémentaire de la langue subsiste à travers ses diverses « transmutations », aussi bien dans un autre code que dans une forme autre de communication. C’est peut-être même ce qui dure et subsiste enfin, au delà des troubles profonds du langage, “passant” du sens malgré tout, et produisant donc un effet par les moyens variés du contact physique, matériel, grâce à quoi le monde effondré de certaines catastrophes peut garder une face sémantisée, communicante, c’est-à-dire humaine. Parfois compassionnelle autant qu’une caresse (le « toucher » de Hölderlin), pourquoi pas. En d’autres termes, encore et toujours traduisible.
____________________________________________________________
[1] Mia Lecomte, Voix poétiques des Italiens d’ailleurs – La poésie transnationale italophone (1960-2016) : thèse, Univ. Paris 3, 2016 (430 p.) ; éd. ital. Di un poetico altrove – Poesia transnazionale italofona (1960-2016), Firenze, F. Cesati, 2018 (335 p.).
[2] Voir, respectivement, site CIRCE et notre Blog Une autre poésie italienne : http://circe.univ-paris3.fr/Lorenzo_Calogero.pdf ; http://uneautrepoesieitalienne.blogspot.com/ .
[3] A fortiori à celle des littératures comparées. Sur ce point, je me permets de renvoyer à ma contribution au volume collectif (dir. Anna Dolfi) Traduzione e poesia nell’Europa del Novecento, Roma, Bulzoni, 2004, “Traduzione e studi letterari: Una proposta quasi teorica” (p. 33-52).
[4] Ce que voulait signifier le titre de mon ancien D’écrire la traduction, Paris, PSN, 1996 (20002).
[5] Voir par exemple : “Bilinguismes ou bi-appartenances”, Babel 18, 2008, p. 121-27 (en ligne : http://journals.openedition.org/babel/288 ), intervention au colloque de Sienne « Ripensare il Mediterraneo », mai 2008.
[6] Cité également dans : Pietro Scarnera, Une étoile tranquille, Paris, Rackham, 2015 (p. 171). Coups d’arrêt de Henri Michaux (naturalisé français) a été republié chez Unes en 2018 (p. 19). On faisait allusion plus haut aux toponymes arabes en -ès (Haouès, Béni-Abbès…), à l’insulte bagasce “prostituées” (vivace en Italie du sud), à une lecture de surface courante de l’inscription Chemiserie moderne.
[7] Sylvie KandÉ, Gestuaire, Paris, Gallimard, 2016.