Par Karim Moutarrif
Toi ma fille, cet être qui m’a donné l’amour que personne ne m’a jamais donné, je sais qu’ils vont médire mais ne les écoute pas. Tu es la seule qui me connaît vraiment. Tu es la seule qui connaît ton père. En Amérique j’ai appris qu’on pouvait me coller le sobriquet de looser. Il a fini par m’inspirer une chanson que j’aurais mise dans la bouche de John Lee Hooker, post mortem. En fait ce vieux, c’était moi. Je rentre et je sors de ma vie pour me voir de l’extérieur. D’ailleurs un jour je la chanterais cette chanson. Ton papa t’adore et tu es la prunelle de ses yeux. Mais les batailles de ton papa on fait de lui quelqu’un qui refuse les compromis douteux. Ceux que l’on fait pour survivre dans l’indignité. J’ai toujours rêvé du jour où tout cela s’arrêtera pour vivre le reste en tranquillité avec toi proche de moi. Tu es ma plus belle réalisation, l’être dont je suis le plus fier au monde, la plus belle fleur que j’ai jamais cultivé.
Aujourd’hui, loin de toi je n’ai plus de sens. Je sens une profonde douleur silencieuse qui me taraude en secret, dans le plus profond de mon corps. Un papa a-t-il le droit d’aimer son enfant et de le crier au plus fort sans faire de bruit.
Je n’entends plus « papa » autour de moi. Brutalement. Parfois quand je l’entends dans la rue, il m’arrive de confondre, d’être perdu dans l’espace. Je crois que c’est toi, je deviens fou une fraction de seconde. Je me dis « Mon Dieu j’ai oublié ma fille, quelque part » ; Comme parfois cela peut arriver quand les enfants sont en bas âge. Je m’attends à ce que, en me retournant, je te vois arriver en courant avec un immense sourire pour te jeter dans mes bras et me donner un câlin. C’est ainsi quand tu n’es pas là. Et pourtant, en haut de la vague, la puissance de ma pensée est infinie. J’ai toujours cru que dans ma tête, ma pensée était un désert sans fin que je parcourais en long et en large, sans être importuné, même dans une foule immense. C’est dans ces moments là que je me ressourçais. Que je rêve de partir avec toi sur un grand voilier pour découvrir le monde, connaissant ta curiosité naturelle, toi qui n’as peur ni des souris ni des éléphants. Quand on écrit la tendresse c’est forcément poétique.

Je pense à toi parce que je suis seul et loin de toi. Mais pas si loin par la pensée. Je t’aime mon enfant, mes tripes, mon sang. Tu es ma muse, ma plus belle source d’inspiration
Sur cette route qu’avaient déjà parcouru mes ancêtres, je me rapprochais de toi. Comme si les dieux de l’Olympe entendaient ma peine muette.
Loin de toi, bohémien à la recherche d’un absolu toujours plus loin, je me sentais coupable. De ne pas être là.
La grande déception ; celle qui se lisait sur son visage, à cet homme qui avait révolutionné le regard sur la vie, c’était de découvrir que l’espèce dite supérieure était pire que les autres. Il s’appelait Darwin. Charles Darwin.
Cependant, un soir, au pays des bédouins je fis une autre découverte qui m’affligea d’avantage. D’ailleurs pour pouvoir assumer sa transcription, je m’étais affublé de la musique de mon ami Jean-Jacques. Fidèle compagnon depuis le dernier quart du siècle dernier. Ce soir là, avec mon ami et mon frère, nous étions emportés par ce que l’on appelle d’un nom peu français, la play station, a simuler une partie de balle au pied, pour ne pas conforter l’usage des mots anglais à outrance, quand nous entendîmes les chiens aboyer. En fait, nous avions l’habitude, chaque soir une bande de chiens sortis de nulle part, de jour ils n’existaient pas ou ils dormaient, étant donné leurs virées nocturnes. Ils sortaient de la carrière que le peuple avait squatté juste devant chez lui ; Comme les systèmes d’alarmes étaient d’une civilisation lointaine trop sophistiquée, les chiens restaient une valeur sure et un coup de pied pouvait les arrêter. Mais pas la nuit. Ils se mettaient au milieu d’une vaste esplanade et on les voyait confortablement installés ; narguant la gent humaine ; Ils contrôlaient le trafic sur la route et pour peu qu’ils tombent sur quelque proie effrayée, leur soirée était confirmée.
Ce soir là ils se mirent à aboyer comme de coutume, plutôt que d’accoutumée, sauf que dans la chorale des gueules aboyantes, l’une était plaintive.
Mon ami et moi savions que de temps en temps un humain jetait une pierre qui atteignait la cible et un couinement suivait sans plus. Cette fois ci l’aboiement était plaintif et durait depuis un moment, ce qui nous intrigua ; Nous nous enquîmes de l’état des choses et pour ce faire, nous allâmes à la fenêtre. Quelle ne fut pas notre surprise quand nous découvrîmes que la meute s’affairait autour d’un autre chien. Le plus costaud était en train de l’étouffer méthodiquement, l’ayant saisi par la gorge et deux autres étaient déjà en route pour un dépeçage en règle.
Nous fûmes fascinés par la scène incroyable et effroyable qui se déroulait devant nos yeux, impuissants. Soudain j’eus un déclic, et je dévalais les deux étages et sorti, me saisis de pierre et dispersait la meute. Du milieu de cette horde se détacha un chien qui déboula sans demander son reste, je le vis traverser l’esplanade à une vitesse vertigineuse et disparaître dans la nuit. Nous étions persuadés que quelqu’un le retrouverait mort. En fait il ne faisait manifestement pas partie de la bande et mal lui en prit d’avoir quitté son territoire. Sans notre intervention, il aurait été dépecé vivant par ses semblables qui hantaient les alentours à l’état semi sauvage. Il y avait longtemps que je n’avais vu une pareille violence animale
La conversation téléphonique avait commencé par une série de jurons en espagnol. C’était mon hôte qui arrosait son interlocuteur. J’ai entendu cabron, ça me rappelait quelque chose.
C’était Barcelone. J’avais déjà entendu ça adolescent ; en visite chez un oncle, qui habitait une île ibérique. Mais j’hallucinais quand même, vu le ton mi-figue mi-raisin. Je me demandais quelle était la prochaine étape. Mais des mots plus ironiques surgirent. Ironiques mais quelque peu hargneux. Le tout dans une langue ibérique que j’avais peu de mal à suivre ayant moi-même été moulé au gaulois et au latin. La conversation évoluait, un véritable suspens y persistait. Puis surgit un que tal caro. La tension chuta d’un coup vers un soulagement. Tout au long, je percevais la voix du répondant. Douce et pénitente. Le ton se fit soulagé. Après avoir tiré tous les missiles, intercalés de comment va ta compagne, comment va ta fille et toutes ces cordes sensibles qui vous ramollissent le pire des interlocuteurs, mon hôte glissa sa vraie question..
C’était une joute. Ce fut les affaires qui embarquèrent et là je compris le sens de la comédie humaine. Il était très bon. Même sur la meilleure des scènes, je n’aurais pas vu mieux. En plus avec la motivation. Il voulait lui arracher un rendez-vous mais avec l’air de se faire prier. Il y réussit. On sentait qu’il contrôlait la conversation. Il avait pris la barre et faisait voguer le bateau à sa guise. La nature humaine était fascinante. Dieu que l’on pouvait être fourbe, même si je n’y croyais plus depuis très longtemps. Comment le verbe peut être manipulé pour fabriquer la conviction. Avec le sourire en sus, mais rien n’est gratuit, surtout dans certaines têtes. J’étais spectateur d’un spectacle de la vie en live. Un spectacle qu’aucune caméra ne captera. Et pourtant on peut mieux faire que ça, juste en étant vrai. C’est le seul vrai spectacle, grandeur nature, celui de l’authenticité.
L’hypocrisie était omniprésente, il faut que je le dise. Une hypocrisie de mise ; Et ça me donnait toujours de l’urticaire. Je buvais une bière comme dans certaines contrées on pouvait en boire pignon sur rue. Mais là dans ces autres contrées où l’on fabriquait le vin mais on prétendait ne pas le boire, comme si les enfants du bon dieu étaient des canards sauvages, on refusait de me servir ou alors il fallait se cacher, pour en boire, c’est terrible. Il fallait donc se sentir coupable avant d’avoir jeté la gorgée pour arroser et calmer les génies des lieux. Je languissais cette liberté à laquelle j’étais habitué dans ces fameuses contrées ou l’on n’a de compte à rendre à personne.
Parce que justement, j’étais tanné de devoir rendre des comptes quand je n’avais pas à le faire. Vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi. Je revendiquais très fort ma liberté. Celle qui m’avait été retirée si souvent, pendant longtemps, sous prétexte que je n’étais pas assez grand pour savoir ce que je faisais. C’est pour ça que j’ai envoyé c…. le roi, mon père et toute cette bande de moralistes faux culs.
Etais je un spécialiste des histoires tordues ? Je ne saurais dire. Je vivais avec ma conscience et je gardais une confiance en la parole de mes semblables contre vent et marée. Il se trouvait que cette confiance me jouait des tours, par le passé comme pour le présent. Mais comme disait l’honorable La Bruyère, vous le croyez dupe mais s’il feint de l’être lequel des deux est dupe. Je trouvais ça fort. Une maxime qui m’a beaucoup aidée chaque fois que je me suis demandé si j’étais niaiseux .
Cette confiance m’avait mené à travers un périple qui avait commencé dans le Nouveau Monde, rebondit en Europe et en Afrique, puis à nouveau en Europe.

Le voyage en Europe était une quête d’amour auprès du seul être qui m’en prodiguait comme je le lui rendait. Ma petite fleur avait décidé de suivre sa mère et moi, j’avais senti que ma vie se viderait brutalement sans la présence de cette enfant. Je devais la suivre, changer de pays quêter du travail et donc recommencer un paquet de singeries qui me donnaient des boutons et pour lesquelles je me préparais psychologiquement.
Je trouvais la Vieille Europe excitée et polluée mais je n’avais pas le choix même si je n’étais plus très compétitif sur le marché du travail. Les amis avaient parfois des attitudes difficilement compréhensibles. Ils vous démolissaient en douceur. Après expérience c’était à se demander ce qu’était l’amitié. Une manière de consolider dans leur tête leurs acquis. Les miens, je n’en parlais pas, ils m’étaient trop chers.
J’étais dans Scarface, la cocaïne était devenu un produit de consommation courante et les consommateurs ne faisaient même plus attention. Il y en avait sur leur bureau, sur l’étagère de la salle de bain, sur le carreau de céramique de la table du balcon. Sur fond de machisme et d’adultère. Avec des femmes straight et des maîtresse nocturnes adeptes de la poudre blanche.
Poursuivies par des hommes frustrés de leur mariage ; après deux ou trois mouflets élaborés ;
Des vies parallèles construites sur le mensonge et la trahison.
C’est ainsi que je me suis retrouvé dans ce film. Sans argent, j’ai vécu trois semaines dans une agence de voyage pour un voyage surréaliste. C’était tout ce que mon hôte avait à m’offrir.
Une histoire de fou. Il jouait à cache cache. Nous étions parti pour un rendez vous professionnel. Je ne savais pas que c’était sa maîtresse. La rencontre fut tardive et elle se prolongera jusqu’au lendemain. Ne connaissant pas la ville je dépendais de mon hôte qui m’hébergeait également chez lui. Je compris que ce n’était pas la première fois qu’il se payait ce genre d’escapade. Comment pouvais je le savoir. Nous ne nous étions pas vu depuis presque vingt ans. Je fus donc expulsé de la maison pour complicité et dès lors pendant trois semaines j’eus droit à un régime très particulier. Je devins prisonnier. N’ayant pas d réserves financières, je devais en principe commencer le travail avec lui. J’étais venu avec la confirmation que je démarrerais dès mon arrivée ; J’aurais pu devenir fou tellement j’étais isolé. Je vivais dans un local d’agence avec un système d’alarme qu’il fallait actionner sans se tromper, une multitude de portes qu’il fallait fermer. Des conditions d’hygiène très limitées. Je me lavais dans les toilettes et je dormais dans une pièce étroite et sans ouverture. Je ne connaissais ni la ville ni les gens, je n’avais pas d’argent. J’étais un otage et je n’avais d’autre choix que d’attendre ;
Ecrire c’est- ce qui empêche de devenir fou. Ecrire c’est le silence ou un monologue intérieur ou un dialogue entre je et moi que personne n’est prêt à entendre. Châtier le verbe pour aérer ses blessures, pour les soigner à la cendre, de façon vernaculaire pour se rapprocher de ce que nous étions, que nous sommes plus, que nous pourrions redevenir
En réalité, il fallait finir par nommer les choses. J’étais dans une ville du nord de l’Ibérie, et j’étais, comme Choukri, saoul d’alcool et d’un bon repas et bien paysan. Sans complaisance, on vous plaçait d’office une grosse bouteille de vin sur la table. C’était comme ça ici, on honorait le sang du Christ, comme moi, un païen.
Heureusement, le train est une expérience onirique grandeur nature. Le paysage qui défile à une vitesse vertigineuse à travers le paysage ; Et nos yeux qui ne peuvent qu’être fascinés. C’est pour cela que l’on glisse très vite dans le féerique et le rêve. Pour l’instant il se glissait dans les entrailles de la ville. De jour nous n’en vîmes point pendant un bon moment mais ce qui devait arriver arriva. Quand nous sortîmes vers le jour le ciel était bas il faisait gris. La voie ferrée était longée de palmiers et plus tard la montagne se découvrit. Comme dans un parc d’attraction, au passage des viaducs on plonge le regard vers le bas pour saisir le vertige de la profondeur, et quand le monstre plonge dans la vallée, les yeux s’accrochent aux maisons agrippées aux versants de la vallée qui nous écrasent en nous surplombant. Le train est chaque fois parc d’attraction qui nous ramène à l’enfance. Et depuis l’enfance c’est toujours la même sensation. Et justement, la montagne se dissipa pour laisser place à la mer. Des jeunes filles se demandaient comment s’appelait cette .mer. La géographie se perdait avec les générations. Le train longeait la route au sortir de la ville. Un trouffion saoul s’effouarait sur deux banquettes ; Le soleil se couchait tard ce soir et la fin de sa course continuait de nous éclairer.
Je m’éloignais de Barcelone.
 Y solo eso, el verte, lejana, tan lejana, con tu callado amable, me ha quitado esperanza. Tu arma siempre ha sido la distancia y el silencio; el tuyo y el del mundo. Un vacío que acaba con todo lo que amo, mi país, mi pasado, la serenidad, lo que creo, tú, día con día, momento a momento. Entonces voy de camino a una ciudad en busca de no sé qué y tal vez en busca de nada, y así los encuentro a ellos, a todos, esas bestias aladas, esas bestias de cortezas, feroces vorágines de ramas, animales petrificados que han sucumbido al tiempo, como anómalos genes vueltos hojas, células de corteza y olmo.
Y solo eso, el verte, lejana, tan lejana, con tu callado amable, me ha quitado esperanza. Tu arma siempre ha sido la distancia y el silencio; el tuyo y el del mundo. Un vacío que acaba con todo lo que amo, mi país, mi pasado, la serenidad, lo que creo, tú, día con día, momento a momento. Entonces voy de camino a una ciudad en busca de no sé qué y tal vez en busca de nada, y así los encuentro a ellos, a todos, esas bestias aladas, esas bestias de cortezas, feroces vorágines de ramas, animales petrificados que han sucumbido al tiempo, como anómalos genes vueltos hojas, células de corteza y olmo.
 Entonces, con el paso temeroso, la llovizna en el cielo, la noche que cae, sin saber donde andar, me pierdo, entre conglomerado de ojos, los del ciego. Un Homero vuelto sauce. Y es así que los encuentro, a todos ellos, las bestias, esas bestias de ramas y hojas, ojos que me siguen y persiguen. Tomo el aliento para seguir huyendo. Mas, no puedo más. Los árboles me llevan a un paraje, el de un bestiario donde nosotros, los de carne y hueso, nos hemos vuelto piedra, un mármol acabado por la lluvia, el dolor mismo, una sepultura de la historia.
Entonces, con el paso temeroso, la llovizna en el cielo, la noche que cae, sin saber donde andar, me pierdo, entre conglomerado de ojos, los del ciego. Un Homero vuelto sauce. Y es así que los encuentro, a todos ellos, las bestias, esas bestias de ramas y hojas, ojos que me siguen y persiguen. Tomo el aliento para seguir huyendo. Mas, no puedo más. Los árboles me llevan a un paraje, el de un bestiario donde nosotros, los de carne y hueso, nos hemos vuelto piedra, un mármol acabado por la lluvia, el dolor mismo, una sepultura de la historia.




 Mais s’il nous est venu le désir d’en reparler aujourd’hui, ce n’est pas seulement pour souligner une fois encore les qualités de ce spectacle… Un « détail » nous a frappés, qui résonne, de manière troublante, avec notre actualité. Paris, seconde moitié des années 30: Irène est en train de lire Gringoire, dont le public peut voir le titre qui s’étale en première page, chassez les étrangers (la phrase revient par la suite). Comme on sait, ce journal politique, littéraire et satirique, dès le début des années 30, alimente la xénophobie qui ne fera que croître par la suite en France. La haine des étrangers se conjugue avec une violente campagne antisémite: le complotisme en vogue à cette époque reproche aux Juifs de vouloir la guerre, de propager les idées communistes ou à l’inverse d’accumuler la richesse au détriment du peuple, de favoriser l’immigration génératrice de désordres. Nous ne savons que trop à quelle tragédie ce délire a conduit l’Europe (Gringoire a aussi publié de nombreux récits d’Irène Némirovsky, les derniers sous un pseudonyme: mais cela ne l’a pas protégée de la déportation et de la mort, et lui a même valu, auprès de ses détracteurs, l’absurde et injuste étiquette de « Juive qui hait les Juifs »)
Mais s’il nous est venu le désir d’en reparler aujourd’hui, ce n’est pas seulement pour souligner une fois encore les qualités de ce spectacle… Un « détail » nous a frappés, qui résonne, de manière troublante, avec notre actualité. Paris, seconde moitié des années 30: Irène est en train de lire Gringoire, dont le public peut voir le titre qui s’étale en première page, chassez les étrangers (la phrase revient par la suite). Comme on sait, ce journal politique, littéraire et satirique, dès le début des années 30, alimente la xénophobie qui ne fera que croître par la suite en France. La haine des étrangers se conjugue avec une violente campagne antisémite: le complotisme en vogue à cette époque reproche aux Juifs de vouloir la guerre, de propager les idées communistes ou à l’inverse d’accumuler la richesse au détriment du peuple, de favoriser l’immigration génératrice de désordres. Nous ne savons que trop à quelle tragédie ce délire a conduit l’Europe (Gringoire a aussi publié de nombreux récits d’Irène Némirovsky, les derniers sous un pseudonyme: mais cela ne l’a pas protégée de la déportation et de la mort, et lui a même valu, auprès de ses détracteurs, l’absurde et injuste étiquette de « Juive qui hait les Juifs »)

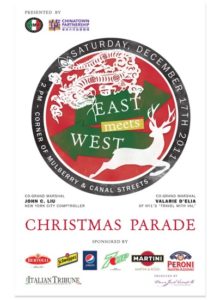
 Crime et châtiment: le titre du célèbre roman de Dostoïevski aurait aussi bien pu être celui du livre publié par Didier Fassin en janvier dernier, Punir, une passion contemporaine. L’auteur reprend d’ailleurs à l’écrivain russe le terme de châtiment et en revendique pleinement la connotation littéraire; ce choix lexical, comme il s’en explique dans l’avant-propos de l’ouvrage, permet de prendre de la distance aussi bien par rapport au sens commun que par rapport à la pensée juridique. Les réflexions de D. Fassin sur la « passion de punir » ont en effet une portée philosophique, anthropologique et politique bien plus large, même si elles s’appuient aussi sur la théorie juridique.
Crime et châtiment: le titre du célèbre roman de Dostoïevski aurait aussi bien pu être celui du livre publié par Didier Fassin en janvier dernier, Punir, une passion contemporaine. L’auteur reprend d’ailleurs à l’écrivain russe le terme de châtiment et en revendique pleinement la connotation littéraire; ce choix lexical, comme il s’en explique dans l’avant-propos de l’ouvrage, permet de prendre de la distance aussi bien par rapport au sens commun que par rapport à la pensée juridique. Les réflexions de D. Fassin sur la « passion de punir » ont en effet une portée philosophique, anthropologique et politique bien plus large, même si elles s’appuient aussi sur la théorie juridique.
