Giacomo Leopardi
Pubblichiamo questo piacevolissimo, fantastico testo di Giacomo Leopardi (1798-1837) che fa parte dei “Pensieri”, non solo perché fantastico e piacevolissimo, che basterebbe, ma perché va contro la corrente culturale, artistica, intellettuale del momento. Un momento di sovraffollamento libresco e autoriale che, in un crescendo allucinante, dura da circa quattrocento anni. Samuel Daniel, poeta inglese contemporaneo di John Florio alias Shakespeare di cui era amicissimo nonché cognato, dedica un testo di encomio a Florio per la sua traduzione dei Saggi di Montaigne. Il poema si trova all’inizio del libro pubblicato nel 1603 e così esordisce
To my deere friend M. Iohn Florio, concerning his translation of Montaigne./Bookes the amasse of humors, swolne with ease, /The Griefe of peace, the maladie of rest, /So stuffe the world, falne into this disease,/As it receives more than it can digest
(…) And have too many bookes, yet want we more,
Libri, una massa di umori, cresciuti a dismisura che ci rovina pace e riposo.Riempiono il mondo che ne riceve più di quanti possa digerirne, ce ne sono troppi ma ne vogliamo di più. Oltre due secoli dopo, agli albori dell’industria culturale, in Italia e non in Inghilterra, Leopardi perfettamente cosciente del rischio annunciato duecento anni prima da Daniel stigmatizza quello che ormai è diventata una realtà irrimediabile
Parlo del vizio di leggere o di recitare ad altri i componimenti propri: il quale, essendo antichissimo, pure nei secoli addietro fu una miseria tollerabile, perché rara; ma oggi, che il comporre è di tutti, e che la cosa più difficile è trovare uno che non sia autore, è divenuto un flagello, una calamità pubblica, e una nuova tribolazione della vita umana.

Illustration:
Jacques Cournoyer
mais maintenant que tout le monde se mêle de créer et qu’il n’est rien de plus difficile que de trouver quelqu’un qui ne soit point auteur
(voir en français Pensée XX: https://books.google.fr/books?id=9q4OnYLhNsC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false)
e
Ma oggi la cosa è venuta a tale, che gli uditori, anche forzati, a fatica possono bastare alle occorrenze degli autori.
Oggi, verso la fine della fase cartacea, ci sono davvero più autori che ascoltatori/lettori/spettatori. Tutti scriviamo e “pubblichiamo” cercando vittime in carne ed ossa nello spazio immateriale della Rete…
LT
_________________________________________________________________________
PENSIERI
XX
Se avessi l’ingegno del Cervantes, io farei un libro per purgare, come egli la Spagna dall’imitazione de’ cavalieri erranti, così io l’Italia, anzi il mondo incivilito, da un vizio che, avendo rispetto alla mansuetudine dei costumi presenti, e forse anche in ogni altro modo, non è meno crudele né meno barbaro di qualunque avanzo della ferocia de’ tempi medii castigato dal Cervantes. Parlo del vizio di leggere o di recitare ad altri i componimenti propri: il quale, essendo antichissimo, pure nei secoli addietro fu una miseria tollerabile, perché rara; ma oggi, che il comporre è di tutti, e che la cosa più difficile è trovare uno che non sia autore, è divenuto un flagello, una calamità pubblica, e una nuova tribolazione della vita umana.
E non è scherzo ma verità il dire, che per lui le conoscenze sono sospette e le amicizie pericolose, e che non v’è ora né luogo dove qualunque innocente non abbia a temere di essere assaltato, e sottoposto quivi medesimo, o strascinato altrove, al supplizio di udire prose senza fine o versi a migliaia, non più sotto scusa di volersene intendere il suo giudizio, scusa che già lungamente fu costume di assegnare per motivo di tali recitazioni, ma solo ed espressamente per dar piacere all’autore udendo, oltre alle lodi necessarie alla fine. In buona coscienza io credo che in pochissime cose apparisca più, da un lato, la puerilità della natura umana, ed a quale estremo di cecità, anzi di stolidità, sia condotto l’uomo dall’amor proprio; da altro lato, quanto innanzi possa l’animo nostro fare illusione a se medesimo; di quello che ciò si dimostri in questo negozio del recitare gli scritti propri. Perché, essendo ciascuno consapevole a se stesso della molestia ineffabile che è a lui sempre l’udire le cose d’altri; vedendo sbigottire e divenire smorte le persone invitate ad ascoltare le cose sue, allegare ogni sorte d’impedimenti per iscusarsi, ed anche fuggire da esso e nascondersi a più potere, nondimeno con fronte metallica, con perseveranza meravigliosa, come un orso affamato, cerca ed insegue la sua preda per tutta la città, e sopraggiunta, la tira dove ha destinato. E durando la recitazione, accorgendosi, prima allo sbadigliare, poi al distendersi, allo scontorcersi, e a cento altri segni, delle angosce mortali che prova l’infelice uditore, non per questo si rimane né gli dà posa; anzi sempre più fiero e accanito, continua aringando e gridando per ore, anzi quasi per giorni e per notti intere, fino a diventarne roco, e finché, lungo tempo dopo tramortito l’uditore, non si sente rifinito di forze egli stesso, benché non sazio. Nel qual tempo, e nella quale carnificina che l’uomo fa del suo prossimo, certo è ch’egli prova un piacere quasi sovrumano e di paradiso: poiché veggiamo che le persone lasciano per questo tutti gli altri piaceri, dimenticano il sonno e il cibo, e spariscono loro dagli occhi la vita e il mondo. E questo piacere consiste in una ferma credenza che l’uomo ha, di destare ammirazione e di dar piacere a chi ode: altrimenti il medesimo gli tornerebbe recitare al deserto, che alle persone. Ora, come ho detto, quale sia il piacere di chi ode (pensatamente dico sempre ode, e non ascolta), lo sa per esperienza ciascuno, e colui che recita lo vede, e io so ancora, che molti eleggerebbero, prima che un piacere simile, qualche grave pena corporale. Fino gli scritti più belli e di maggior prezzo, recitandoli il proprio autore, diventano di qualità di uccidere annoiando: al qual proposito notava un filologo mio amico, che se è vero che Ottavia, udendo Virgilio leggere il sesto dell’Eneide, fosse presa da uno svenimento, è credibile che le accadesse ciò, non tanto per la memoria, come dicono, del figliuolo Marcello, quanto per la noia del sentir leggere.
Tale è l’uomo. E questo vizio ch’io dico, sì barbaro e sì ridicolo, e contrario al senso di creatura razionale, è veramente un morbo della specie umana: perché non v’è nazione così gentile, né condizione alcuna d’uomini, né secolo, a cui questa peste non sia comune. Italiani, Francesi, Inglesi, Tedeschi; uomini canuti, savissimi nelle altre cose, pieni d’ingegno e di valore; uomini espertissimi della vita sociale, compitissimi di modi, amanti di notare le sciocchezze e di motteggiarle; tutti diventano bambini crudeli nelle occasioni di recitare le cose loro. E come è questo vizio de’ tempi nostri, così fu di quelli d’Orazio, al quale parve già insopportabile; e di quelli di Marziale, che dimandato da uno perché non gli leggesse i suoi versi, rispondeva: per non udire i tuoi: e così anche fu della migliore età della Grecia, quando, come si racconta, Diogene cinico, trovandosi in compagnia d’altri, tutti moribondi dalla noia, ad una di tali lezioni, e vedendo nelle mani dell’autore, alla fine del libro, comparire il chiaro della carta, disse: fate cuore, amici; veggo terra.
Ma oggi la cosa è venuta a tale, che gli uditori, anche forzati, a fatica possono bastare alle occorrenze degli autori. Onde alcuni miei conoscenti, uomini industriosi, considerato questo punto, e persuasi che il recitare i componimenti propri sia uno de’ bisogni della natura umana, hanno pensato di provvedere a questo, e ad un tempo di volgerlo, come si volgono tutti i bisogni pubblici, ad utilità particolare. Al quale effetto in breve apriranno una scuola o accademia ovvero ateneo di ascoltazione; dove, a qualunque ora del giorno e della notte, essi, o persone stipendiate da loro, ascolteranno chi vorrà leggere a prezzi determinati: che saranno per la prosa, la prima ora, uno scudo, la seconda due, la terza quattro, la quarta otto, e così crescendo con progressione aritmetica. Per la poesia il doppio. Per ogni passo letto, volendo tornare a leggerlo, come accade, una lira il verso. Addormentandosi l’ascoltante, sarà rimessa al lettore la terza parte del prezzo debito. Per convulsioni, sincopi, ed altri accidenti leggeri o gravi, che avvenissero all’una parte o all’altra nel tempo delle letture, la scuola sarà fornita di essenze e di medicine, che si dispenseranno gratis. Così rendendosi materia di lucro una cosa finora infruttifera, che sono gli orecchi, sarà aperta una nuova strada all’industria, con aumento della ricchezza generale.

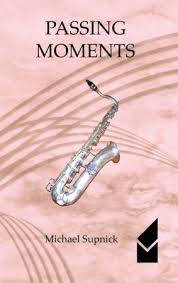 Connaissez-vous la Gennet Record Company, Richmond, Indiana, Bix Beiderbecke, les flapper girls, le lindy hop, la shim sham ? Non ?! Ce sont pourtant les lieux, les personnages et les danses qui ont accompagné la légende du Jazz. Et c’est cette histoire passionnante que nous dévoile en italien Michael Supnick dans ce roman surprenant dont le titre, tiré sans doute d’une pièce de jazz, est déjà tout un programme : Passing moments. Tout commence par le plus banal des hasards : l’acquisition d’un vieux saxophone acheté sur Internet. Mais l’année de sa fabrication -1912- intrigue ce jazzman accompli, américain de naissance et italien d’adoption, qui a plus de 70 enregistrements à son compteur. Se pourrait-il que ce saxophone ait été le témoin de l’histoire du jazz ? Il n’en fallait pas plus pour allumer l’imagination de Supnick qui aussitôt s’enquiert du premier propriétaire de l’instrument. Les quelques éléments glanés lui suffisent pour brosser la trame d’une histoire qui se révèle par petites touches, comme un secret de famille. Et qui pour lever ce secret sinon un jeune garçon de huit ans dont la curiosité l’amène à découvrir dans le grenier de la maison un vieille malle obstinément fermée. Que contient-elle et pourquoi la valise à ses côtes, remplie de robes de bal des années trente disparaît-elle aussitôt que Jimmy, c’est le nom du petit garçon, en parle à sa mère ? Nous sommes le 29 mars 1967 , à Richmond , Indiana, au cœur de la Bible Belt mais qui fut aussi un temps le cœur vibrant des Roaring Twenties : les années 20 américaines. Pour la raconter Supnick construira deux récits en parallèle : le premier est celle de l’histoire du jazz qui va de 1923 à la fin des années 60 ; le second part justement de cette période, celle de la redécouverte, jusqu’ à sa reconnaissance dans les années 80. Cette trame alternera et finira par se confondre comme les branches du caducée , le 13 mai 1980 dans un chapitre conclusif qui s’intitule justement « La réhabilitation ». Car cette entreprise est bien celle de la réhabilitation de la mémoire occultée où Jimmy découvrira la véritable histoire de son grand-père paternel, Boogie Windham, jazzman à ses heures, mais surtout de son grand oncle Windy, petit génie du saxophone et propriétaire de l’instrument. C’est à travers lui, sa vie, ses espoirs mais aussi ses déconvenues que le narrateur va nous faire découvrir le jazz. Car Windy serait ce qu’on pourrait appeler « un petit maître » ; il aura joué avec les plus grands sans toutefois obtenir son moment de gloire ; moment qui lui sera volé… par un train dont le sifflet s’invite au beau milieu de son solo sur le point d’être gravé. Car le mythique studio d’enregistrement de Richmond se trouvait tout près de la gare de train, (directement connecté avec la Nouvelle Orléans par où remontaient le contingent de jazzmen noirs invités à se faire voir ailleurs par le nouveau maire d’alors). Et les prises d’enregistrement étaient calculées en fonction des horaires des trains.
Connaissez-vous la Gennet Record Company, Richmond, Indiana, Bix Beiderbecke, les flapper girls, le lindy hop, la shim sham ? Non ?! Ce sont pourtant les lieux, les personnages et les danses qui ont accompagné la légende du Jazz. Et c’est cette histoire passionnante que nous dévoile en italien Michael Supnick dans ce roman surprenant dont le titre, tiré sans doute d’une pièce de jazz, est déjà tout un programme : Passing moments. Tout commence par le plus banal des hasards : l’acquisition d’un vieux saxophone acheté sur Internet. Mais l’année de sa fabrication -1912- intrigue ce jazzman accompli, américain de naissance et italien d’adoption, qui a plus de 70 enregistrements à son compteur. Se pourrait-il que ce saxophone ait été le témoin de l’histoire du jazz ? Il n’en fallait pas plus pour allumer l’imagination de Supnick qui aussitôt s’enquiert du premier propriétaire de l’instrument. Les quelques éléments glanés lui suffisent pour brosser la trame d’une histoire qui se révèle par petites touches, comme un secret de famille. Et qui pour lever ce secret sinon un jeune garçon de huit ans dont la curiosité l’amène à découvrir dans le grenier de la maison un vieille malle obstinément fermée. Que contient-elle et pourquoi la valise à ses côtes, remplie de robes de bal des années trente disparaît-elle aussitôt que Jimmy, c’est le nom du petit garçon, en parle à sa mère ? Nous sommes le 29 mars 1967 , à Richmond , Indiana, au cœur de la Bible Belt mais qui fut aussi un temps le cœur vibrant des Roaring Twenties : les années 20 américaines. Pour la raconter Supnick construira deux récits en parallèle : le premier est celle de l’histoire du jazz qui va de 1923 à la fin des années 60 ; le second part justement de cette période, celle de la redécouverte, jusqu’ à sa reconnaissance dans les années 80. Cette trame alternera et finira par se confondre comme les branches du caducée , le 13 mai 1980 dans un chapitre conclusif qui s’intitule justement « La réhabilitation ». Car cette entreprise est bien celle de la réhabilitation de la mémoire occultée où Jimmy découvrira la véritable histoire de son grand-père paternel, Boogie Windham, jazzman à ses heures, mais surtout de son grand oncle Windy, petit génie du saxophone et propriétaire de l’instrument. C’est à travers lui, sa vie, ses espoirs mais aussi ses déconvenues que le narrateur va nous faire découvrir le jazz. Car Windy serait ce qu’on pourrait appeler « un petit maître » ; il aura joué avec les plus grands sans toutefois obtenir son moment de gloire ; moment qui lui sera volé… par un train dont le sifflet s’invite au beau milieu de son solo sur le point d’être gravé. Car le mythique studio d’enregistrement de Richmond se trouvait tout près de la gare de train, (directement connecté avec la Nouvelle Orléans par où remontaient le contingent de jazzmen noirs invités à se faire voir ailleurs par le nouveau maire d’alors). Et les prises d’enregistrement étaient calculées en fonction des horaires des trains.