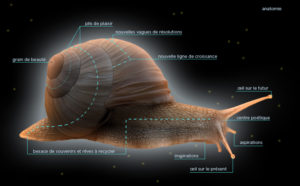Karim Moutarrif
Les gouttelettes de pluie s’échouaient à un rythme soutenu sur la vitre.
La voiture roulait le long du fleuve en surplomb.
En bas on pouvait voir le quai du port fluvial.
Le fleuve était rouge de la terre que les torrents de boue y déversaient.
Le ciel était gris et bas.
Une mélancolie douce l’envahit et lui rappela un autre lieu.
Le ronronnement du moteur l’invita à la léthargie.

Je vis des collines jusqu’à la mer.
Je sentis le vent.
Je marchais dans la campagne mouillée avec mes bottes et mon ciré.
Le champ s’arrêtait de manière brutale au bord de la falaise.
La mer était déchaînée et m’envoyait ses embruns sur le visage.
L’océan paraissait immense et moi, je me sentais tout petit.
L’odeur du fumier, de la terre mouillée et de l’iode se mélangeait.
C’est peut-être pour ça que j’avais aimé cette terre-là.
Mais c’était aussi la terre des druides, des forêts magiques et des menhirs. Des paysages pesants de mystère et de magie propres au monde celtique.
À la fin de la terre.
Quand nous nous sommes rencontrés, il y a longtemps, nous y avons été.
La voiture s’arrêta.
Il était à l’entrée de la ville arabe, grouillante de monde.
Les parfums d’épices assaillirent ses sens.
Il voulait marcher là dans la foule.
Il voulait humer cet air coloré.
Il avait toujours aimé ça.
Quand il quittait les rues principales, il cheminait entre ces demeures bâties de torchis et recouverte de chaux, dans des ruelles étroites.
Un véritable labyrinthe, qu’il s’était complu à reconnaître entièrement autrefois.
Il imaginait le temps des corsaires, les yeux accrochés au bout de ciel bleu.
D’un bleu tout à fait particulier.
Un ciel d’Afrique.
Il donna rendez-vous à son ami de l’autre côté du fleuve.
Quand je marchais dans la médina, j’étais sûr d’oublier le métal, le rationnel et tout le tapage de la civilisation.
Quand je passais la muraille, j’entrais dans un monde magique.
Une ville conçue pour des êtres humains.
Construite avec la terre et ancrée dans la terre.
Quand je marchais dans la médina, je me perdais dans l’histoire vivante de ses murs humblement de terre.
Je voyageais ainsi dans le temps puisque certaines choses ici sont immuables, le principal était de franchir la frontière entre les deux mondes.
Je pénètre un monde fantastique, je voyage dans le temps
La paix des ruelles retirées est magique.
Puis il déambula ainsi dans le marché aux perles.
Un peu plus loin l’odeur du cuir annonçait les boutiques débordantes d’articles faits de cette matière.
La lumière du soleil striait le pavé au rythme des languettes servant de parasol, donnant un air étrange à l’ensemble, aux marchandises sur les étals et aux humains.
Il finit dans le marché aux puces.
Là on vendait des rebuts de métaux, de ferraille, d’habits et chaussures et autres breloques inutilisables.
Au pied de la muraille fortifiée.
Il flâna à travers ce décor.
Le coeur n’y était plus.
Il aurait voulu qu’elle soit là, qu’il lui serve de guide.
Qu’il la promène dans ce monde des mille et une nuits.
Il regrettait de ne pas avoir pu le faire.
Malgré les apparences, les choses avaient changé.
Comme dans sa vie.
L’industrie du cuir avait balayé bon nombre de ces petits artisans qui constituaient l’âme de ce monde à part.
Il se souvenait.
La vieille ville et ses trésors dépérissaient chaque jour dans l’indifférence générale.
Passé la muraille, je traversais la route et me retrouvais au bord du fleuve.
Et là, des barques assuraient le passage pour une somme modique.
Cette ruse me permettait d’éviter la densité des heures de pointe et de voyager somme toutes dans des conditions beaucoup plus agréables. Au lieu des gaz d’échappement, j’humais l’air du delta et une brise légère me caressait le visage.
Pendant la traversée j’appréciais l’iode de l’océan en le regardant ruer là-bas sur la digue
Sur l’autre rive, je débarquais sur la plage et marchais jusqu’à la ville.
La dernière fois qu’il y était retourné, quinze ou vingt ans plus tard, l’échoppe était close.
Toute la petite cour autrefois grouillante de va-et-vient et d’artisans besogneux s’était tue.
De son ami, le cordonnier plus de nouvelles.

Il ajusta son siège, dérégla son dossier pour l’adapter à ses mouvements.
Il venait d’avoir son affectation.
Il alluma l’écran, composa son nom, prénom et code.
Le nouveau plan de vol s’afficha.
Il alla chercher de l’eau pour ne pas se dessécher la gorge et un crayon à mine et revint s’asseoir.
Il mit son casque et demanda l’autorisation de décollage.
Il prit une inspiration, appuya sur enter.
Le premier numéro de téléphone s’afficha avec toutes les indications complémentaires: nombre d’appels, nombre de refus, rendez-vous, nom.
Par-dessus le cubicule, un bout de ciel passait par la fenêtre.
Il était gris et la vitre était constellée de gouttelettes qui ressemblaient à des joyaux éphémères.
Comme on ne voit nulle part ailleurs.
Dimanche matin, quand tous les bourgeois ont la tête dans le seau de la fête de la veille.
Parfois il les tirait du lit, violeur de la vie privée. Il bredouillait des excuses et pendant quelques secondes il espérait que le prochain ait déjà bu son café avant de décrocher.
Puis il prenait une nouvelle inspiration.
Comment trouvez-vous la vinaigrette que nous avons expédiée chez vous?
La dame est contente. Elle trouve ça excellent.
Un bon point, ça mettra de l’entrain dans le sondage.
À la fin, on lui offre de lui livrer…encore une vinaigrette. Waw! Super! La dame jubile. Elle serait sortie du téléphone pour m’embrasser.
Dans dix jours “Ils” vous rappelleront pour recueillir vos impressions.
Et vous monsieur, si on vous donne un téléphone, plein d’interurbains incompréhensibles et un service téléphonique reviendrez-vous avec nous?
Certainement, moi je suis un fidèle.
Utilisez-vous des condoms comme moyen de contraception?
Faites-vous l’amour, vraiment, peut-être, peut-être pas ou jamais.
Sur une échelle de un à dix où un veut dire “nul” et dix, “sublime”, comment jugez-vous l’onctuosité de la crème à raser unisexe?
Etes-vous conservateur progressiste, votant pour les puritains mais aussi séparatiste?
Il combinait ainsi parfois plusieurs scripts et imaginait le cocktail comique que cela pouvait représenter.
Ils les entendaient tous grogner. Ils étaient tous piégés comme des rats.
Pour eux la société post-industrielle est arrivée par le désert. La dignité en prenait un coup.
Plus de job. Que faire?
Attendre que les sondages reprennent.
Et mon double me disait que j’étais un nègre du capitalisme comme tous mes collègues.
Nous nous faisions cracher à la figure par des gens que nous harcelions sans arrêt.
Tous les jours nous faisions des milliers d’appels téléphoniques pour sonder l’âme d’un peuple hétéroclite.
À la fin de chaque questionnaire, nous déshabillions la personne par une multitude de questions indiscrètes.
Nous étions gênés et payés pour.
Le casque plein les oreilles et l’écran à bout portant.
Les cubicules bien alignés et la moquette grise, nous baignions dans le néon qui rebondissait sur l’écran pour nous percuter la face.
Le raton laveur se roulait dans les feuilles mortes après s’être gavé de pommes mures. Cela aurait pu être un ourson ou un bébé panda. Avec la même grâce et la même insouciance qu’un être libre.
Les feuilles de toutes les couleurs, de l’ocre rouge au jaune doré, virevoltaient de ses roulades.
Parfois, c’était des chevreuils qui venaient déguster les fruits à même l’arbre.
De la fenêtre de cette charmante maison de ferme, ils pouvaient admirer le spectacle avec une vue plongeante sur le lac. Ils regardaient en silence, côte à côte, de la fenêtre de la cuisine.
Il se dégageait une paix infinie de ce tableau.
Ils avaient marché jusqu’au lac aux castors.
Les infatigables travailleurs se hâtaient de faire les dernières réserves avant l’hiver.
L’odeur de l’automne et de l’humus emplissaient le bois.
C’était le début du déclin.
C’était revenu sur son écran pour lui faire oublier sa condition.
Il retomba dans une réalité moins réjouissante.
Instrument de tous les fantasmes de l’argent, nous exécutions froidement ce qu’il y avait à l’écran.
Il faut rappeler après plusieurs refus. La tyrannie du quota à atteindre est impitoyable.
Je n’ai jamais vu pareille indécence. Face au droit de ne pas répondre, d’être supposément libre.
Finalement, c’était comme vouloir obtenir des aveux de personnes qui n’ont rien envie de dire. Par le harcèlement, par des agressions répétées.
Comme ailleurs, on aurait fait pour des raisons politiques.
Ici, c’est pour des raisons de fric – aller vous gratter les derniers sous noirs – mais cela revenait au même dans le fond.
Après le typhon des factures des courses et tout le reste.
Ils vous achèveront et pour vous fermer le clapet, ils diront: “Ah! Mais vous étiez libre de consommer”.
.La valse des questions lui donnait le vertige.
Parfois, il s’entraînait comme au théâtre.
Il travaillait le texte, en français et en anglais, diction et respiration.
Il pataugeait.
Au fur et à mesure que le temps passait, je me rendais compte que je travaillais pour du vent. En fait nous étions la courroie de transmission. Nous étions un laboratoire mobile pour des produits débiles qui se déplaçait au gré du quadrillage téléphonique.
Les besoins étaient, en apparence très loin, nous naviguions dans le désir.
Il ressentit un besoin violent d’oxygène.
Il aurait voulu être à des milliers de kilomètres de là.
Loin du carnage de la consommation et du culte de l’ego.


 De l’autre coté de l’Atlantique, en ce début des années 80, Pier Paolo Pasolini était déjà une figure consacrée de la scène internationale des arts et des lettres. Son assassinat en des circonstances troubles et jamais vraiment élucidées, l’avait propulsé directement au septième ciel aux côté des grands astres de la modernité: Rimbaud, Kafka, Walter Benjamin… L’attestaient l’activité éditoriale et cinématographique demeurées constantes autour de son œuvre. Traductions, hommages et rétrospectives abondaient en effet. Par conséquent, il n’avait pas eu à subir l’habituel “purgatoire” auquel sont condamnés les artistes et écrivains immédiatement après leur décès. Une autre preuve en était le roman biopic
De l’autre coté de l’Atlantique, en ce début des années 80, Pier Paolo Pasolini était déjà une figure consacrée de la scène internationale des arts et des lettres. Son assassinat en des circonstances troubles et jamais vraiment élucidées, l’avait propulsé directement au septième ciel aux côté des grands astres de la modernité: Rimbaud, Kafka, Walter Benjamin… L’attestaient l’activité éditoriale et cinématographique demeurées constantes autour de son œuvre. Traductions, hommages et rétrospectives abondaient en effet. Par conséquent, il n’avait pas eu à subir l’habituel “purgatoire” auquel sont condamnés les artistes et écrivains immédiatement après leur décès. Une autre preuve en était le roman biopic 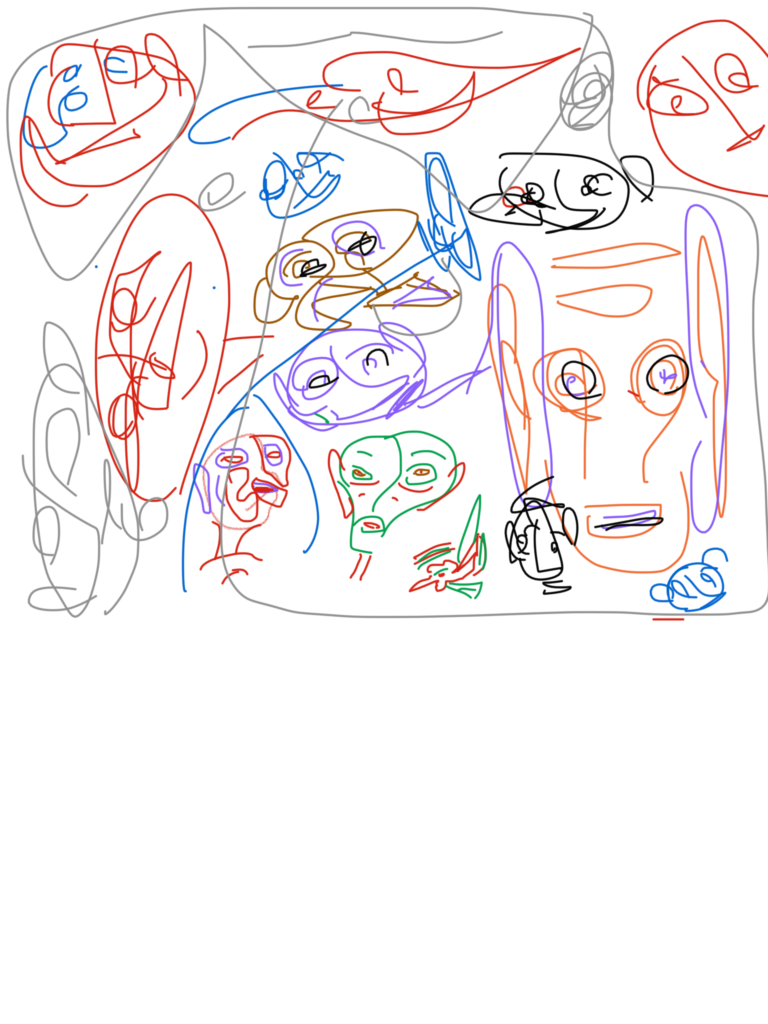 Ce texte est celui de l’allocution d’ouverture du colloque “1985-2005 : vingt ans d’écriture migrante au Québec. Les voies d’une herméneutique”, ( Marc Arino et Marie-Lyne Piccione) Presses universitaires de Bordeaux, 2007.
Ce texte est celui de l’allocution d’ouverture du colloque “1985-2005 : vingt ans d’écriture migrante au Québec. Les voies d’une herméneutique”, ( Marc Arino et Marie-Lyne Piccione) Presses universitaires de Bordeaux, 2007.