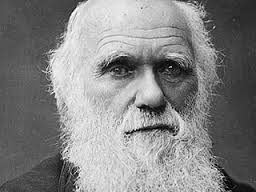Par Karim Moutarrif
Les salles de classes en préfabriqué, avec un poêle au fond et le stock de charbon dans la cour.
Les encriers et l’encre offerte par le gouvernement.
La bouteille et son bec verseur. Et la dictature du maître.
L’école des garçons séparée de celle des filles par un haut mur.
Et le nom de ce maudit ministre qui avait donné la connaissance aux siens et la domination de la race supérieure sur l’ensemble de l’Afrique au même moment, gravé sur le fronton de l’édifice.
Son nom était sur toutes les bâtisses de ce genre construites à travers le pays.
Dans ce temps là, la propagande de la révolution avait besoin d’édifier la machine à modéliser des citoyens, disait son vieux prof un peu, beaucoup à gauche.
Je ne savais pas tout ça quand j’étais petit.
Plus au fond de la campagne, il avait connu aussi les écoles sans noms. Celles installées à la hâte dans des anciennes fermes.
Il fallait marcher à travers les labours pour y accéder.
Ils se retrouvaient en bande sur la route. Une espèce de caravane, chargés comme des mulets de sacs d’école bourrés de cahiers et de livres, plus le casse-croûte.
Dans l’unique salle de classe tout le cours primaire était asséné.
Les gamins de différents âges étaient regroupés selon la classe.
Les cancres étaient stationnés au fond, c’est vrai, ignorés des autres.
Plus de rivière, plus de roseaux.
Ils avaient tout aplani, rasé les fermettes, et derrière, sur un fond de campagne, taillés à la serpe et à l’équerre, on voyait se détacher, comme dessinés sur le plan, l’autoroute et son péage.
Adieu veaux, vaches et fromages.
J’ai continué à marcher pour revoir l’épicerie cantine et la ferme où j’allais chercher le lait de la vache que la fermière trayait devant moi.
L’épicerie avait dû fermer depuis plusieurs années. L’état de décrépitude en témoignait.
Elle était ridiculement petite par rapport à l’image que j’en avais gardé.
La ferme est devenue une fermette, et dans le pacage il n’y avait plus de trace de mammifères depuis longtemps.
Le petit vallon sympathique avait été démantelé, il ne restait plus que les fantômes.

À des milliers de kilomètres de là, c’est vrai qu’il y avait une rivière.
Mais dans le fond c’était encore une image déformée de l’enfance
Elle avait été asséchée.
En fait il n’est jamais bon de se retourner, de revisiter le passé.
On y froisse ses illusions.
Dans ces moments de vertige, où rien ne sert de rse repèrer.
Quand l’amour n’est plus.
Le rêve cassé.
Cette rivière je l’entendrais, trente plus tard.
Elle fut le déclencheur.
C’est le bruit de l’eau qui m’a emporté très loin derrière.
Dans un bois canadien, chez un ami.
Surtout le bruit de l’eau.
Et dans mon désespoir, je me suis réfugié sur le bord de la rivière de mon enfance.
Les grenouilles jouaient une symphonie de leur chant nuptial.
Par une nuit d’été.
Quand une multitude de fleurettes toutes plus belles les unes que les autres font une brève apparition, tapissant un parterre de verdure, éclairé par la lune.
Et l’envie de rêvasser dans ce magnifique tableau.
La rivière en arrière et le bois au fond, au milieu des bruits mystérieux de la forêt.
C’est de là que je venais avant de te rencontrer.
L’odeur du café chatouillait les narines, la maisonnée s’éveillait tranquillement.
La relâche était perceptible dans l’air
C’était samedi, journée des petites annonces.
Ils recevront des montagnes de curriculum vitae.
Ils choisiront tranquillement sur les milliers.
Il souriait devant les définitions de poste comme ils disent.
Les jobs étaient de plus en plus bizarres.
Il y en avait de moins en moins et en fond sonore, on entendait le bruit du vent dans le feuillage des arbres.
De sa fenêtre il pouvait voir un océan de verdure.
C’était le grand show de l’été.
Il n’y avait plus qu’un petit bout de ciel, les feuilles avaient tout envahi.
Il n’y avait que ça de vrai dans le fond.
Le reste n’était qu’artifice.
Le réveil de la nature était à chaque fois une leçon.
Dire que, quand l’hiver les plumait de ses blizzards, ces mêmes arbres semblaient morts à jamais.
Vont-ils fleurir et faire pousser des feuilles comme l’année dernière?
Verra-t-on les bourgeons pointer?
Jusqu’aux dernières provocations des éléments, c’est toujours la grande attente.
Puis un matin en sortant, le miracle s’est produit.
La nuit a porté la vie et au jour, une multitude de petites pousses sont apparues sur les branches.
Pendant ce temps je marche dans la tempête, c’est hallucinant.
La neige avait tout confondu de son immense manteau blanc.
La ville n’avait plus de sens.
Les voitures étaient anéanties, le bitume enterré.
Et je rêve que ça le reste pour toujours
Je suis tout seul dans le paisible tourbillon de neige,
La ville n’existe plus, elle est irréelle.
Je suis un nomade dans le désert blanc.
Je marche dans une matière friable, fragile dans laquelle je m’enfonce.
J’entends le doux crissement de mes pas dans la neige fraîche. Je marche sur un parterre immaculé, d’une blancheur extraordinaire.
Et je pense à toi.

Les halos de lumière des réverbères font miroiter les flocons de coton suspendus qui se déposent doucement, sur mon chapeau, sur mon manteau dans les moindres replis du tissu.
Mon image devient floue et peut-être que je serais effacé de l’image.
Que je disparaîtrais dans le blanc.
C’est vrai que le journal du samedi devait coûter un tronc d’arbre par numéro, facile.
La fin de la lecture était assez tumultueuse.
Il regrettait toujours, une fois le torchon secoué, d’avoir mis autant d’argent dedans.
Mais chaque samedi, il se faisait une petite gâterie: il achetait un tronc d’arbre pour le jeter dans le bac de récupération, une fois écoeuré.
Il était mal à l’aise, avait l’esprit ailleurs.
Je savais déjà que tu me prenais pour un raté.
Tu m’avais dit que je n’étais qu’un pauvre type.
C’est pour ça que j’étais reparti revisiter ma vie.
Depuis la première fois où tu me l’as dit.
Pour comprendre comment se fabriquait un pauvre type.
Les années avaient usé l’amour et je n’avais, pas plus que toi, de contrôle sur ces choses là.
Il avait apporté dans ses bagages tous ses souvenirs et très peu d’effets.
Il les avait posés dans un coin du patio à l’abri de la circulation, sur le zellij aux couleurs de la Méditerranée.
Il imagina des valises en carton, en bon immigrant de retour au pays.
Parfum bon marché et cravate en sus.
Ce qui le ramenait sur ses pas était un rendez-vous très particulier.
Dans un cimetière pour pauvres où la plupart des tombes étaient de terre.
Un décor dénué de fioritures.
Le décor des humbles que l’histoire oublie.
Le taxi l’avait déposé loin là-bas, sur le bord de la route.
Pendant le parcours il avait mesuré les changements.
Il était parti de la Ville des corsaires, en longeant la côte vers le sud.
Il avait traversé le fleuve sur une barque, pris un taxi collectif jusqu’à la limite de la ville, puis avait fini par pendre un taxi à lui tout seul.
Il avait longé les murailles de torchis de l’enceinte “pré-coloniale ” de la ville, comme ils disent dans les bouquins d’experts.
Il avait été surpris par la densité, le nombre de piétons, le bruit.
C’était en fin de journée.
Dieu que j’avais perdu l’habitude, j’aurais du le savoir
Ici aussi, ils bitumaient, rasaient des quartiers, défonçaient des cimetières.
Le sol était réquisitionné pour la rareté.
Ailleurs on parlait de qualité de la vie, de trou dans la couche d’ozone, du cancer provoqué par le tabac, etc.
Il n’y avait pas beaucoup d’arbres dans le décor
La ville minérale, vorace comme une tornade balayait tout sur des dizaines de kilomètres.
Non ce n’est pas San Francisco, mais si ça continue, ils feront plus fort que San Francisco, ce sera un pays minéral.
Mélangé à l’exode rural, à la pauvreté, à l’entassement…, à l’absence de moyens.
Je me souviens de dépotoirs à ciel ouvert, entre les hommes et la mer.
J’avais appris plus tard, à l’école que c’était à l’opposé de ce qu’il fallait faire. Mais mes livres n’avaient pas vu la misère et les enfants jouaient dedans au soleil couchant.
L’aridité donnait des traits ascétiques au paysage.
A beaucoup d’endroits le sol avait été emporté et depuis des décennies plus rien n’y pousse.
Une croûte que même les orages violents ne défont plus.
Ça lui était brutalement revenu à l’esprit.
J’ai marché de la route jusqu’au royaume du silence,
J’ai foulé la poussière rouge jusqu’à l’emplacement.
De toute façon je marchais sur mes espoirs comme j’aurais claqué du talon sur un macadam luisant. La nuit, sous la lumière maussade des réverbères.
Dans le partage des pouvoirs de l’ombre entre deux lampadaires.
La vie peut être vue à travers ces petites choses absurdes, incongrues.
Dans une lecture parallèle tout à fait plausible.
Rien ne l’interdisait.
Debout devant l’endroit où il ne devait plus y avoir qu’un engrais, fixant la pierre tombale, il se mit à parler en français dans un cimetière musulman.
L’épitaphe de marbre avait perdu ses caractères arabes.
Une très belle écriture calligraphique, noire jadis, sculptée dans le marbre.
Il jeta un regard circulaire pour s’assurer de leur intimité et s’entendit dire:
Ça fait bien longtemps que je ne t’ai pas rendu visite, je te boudais maman, je te boudais Mnaya et maintenant je reviens à toi, plus âgé que toi avec toujours la même frustration de ne plus te revoir.
C’est ça la mort vue par les vivants.
Je suis venu te dire que je t’admirais.
Je suis venu te dire que je suis toi.
Il se disait en lui-même que cette espèce de rite païen était absurde, mais c’était plus fort que lui.
Il n’aurait supporté aucune intrusion. Ni la moindre ingérence dans la mise en scène.
C’était à lui, ça lui appartenait tout seul et personne au monde n’aurait pu remettre en question cette exclusivité.
Aucun rationalisme ne pouvait la balayer.
De toute façon, il avait choisi la discrétion pour n’interférer dans l’existence de personne.
Un cimetière au crépuscule, c’est rarement fréquenté.
Et le reste fut laissé à l’océan.
Très peu de personnes venaient se recueillir sur cette tombe.
La mort emporte dans l’oubli.






 Paris, dix-huitième arrondissement.
Paris, dix-huitième arrondissement.