Paru dans le numéro 15 du magazine ViceVersa de mai 1986 cet article d’Émile Ollivier nous parle avec finesse et humour des plaisirs et fantasmes de la table, lieu éminemment transculturel.
Quinze ans après ta disparition nous te saluons, Émile, et levons le verre! http://ile-en-ile.org/ollivier/
Émile Ollivier
Tout commença lorsqu’Esaü échangea son droit d’aînesse contre un plat d lentilles. La cuisine transculturelle y trouve là son mythe fondateur
J’entends déjà de hauts cris: Quoi! Un article sur la cuisine; célébrer le culinaire; inviter à festoyer quand des régions entières de la planète sont en proie à la rareté, à la famine.
J’avoue que les malheurs du monde ne pourront pas me retenir très longtemps de céder à la tentation d’écrire un essai sur l’art de bien manger et les manières de table.

Ai-je besoin de le réaffirmer? Le culinaire, champ de pratiques sociales, a depuis belle lurette droit de cité dans le panthéon des objets nobles du social. Mythologues, ethnologues et anthropologues l’ont clamé: l’histoire de la table est inséparable de l’histoire des peuples. Tout comme le feu, élément capital dans le développement du culinaire, elle a modelé le rapport des hommes avec la nature et leurs rapports entre eux.
La conquête de la nature, depuis le jardin d’Éden, a toujours eu pour dessein la satisfaction des besoins alimentaires de l’homme. La délimitation des territoires, les politiques d’envahissement, les guerres, depuis Babel, n’ont à la limite jamais eu d’autres visées que celles de protéger, d’étendre les éventualités d’une appropriation de plus en plus importante des denrées et des vivres.
L’histoire de la table rejoint donc l’histoire des Origines.
Elle est inséparable de l’histoire des peuples.
Si l’on se fie à la Genèse, le culinaire remonte à la fondation des nations. Yahvé dit i Rébecca: il y a deux nations en ton sein; deux peuples issus de toi se sépareront; un peuple dominera l’autre et l’aîné servira le cadet.
Parole prophétique! La suivre à la trace, la prendre en compte permet non seulement de comprendre les fondements de la domination mais aussi d’en saisir le mécanisme subtil.
Une fois, rapporte la Genèse, Jacob prépara un potage. Esaü revenant de la campagne épuisé, dit à Jacob: «Laisse-moi avaler ce roux, ce roux-là; je suis épuisé.» Jacob répliqua: «Vends-moi d’abord ton droit d’aînesse.» Jacob répondit: «Voici que je vais mourir, à quoi me servira le droit d’aînesse?» Jacob insista: «Prête moi d’abord serment.» Esaü prêta serment et vendit ainsi son droit d’aînesse à Jacob. Alors celui-ci lui donna du pain et du potage de lentilles. Esaü mangea et but, se leva et partit.
Ce passage célèbre de la Genèse est la plupart du temps résumé dans une formule laconique; Esaü vendit à Jacob son droit d’aînesse pour un plat de lentilles.
Assurément, il y a là un geste important puisque le chroniqueur a pris soin de le mettre en évidence. Mais comment le connoter? La touche de mépris avec laquelle le chroniqueur conclut son récit («C’est tout le cas qu’Esaü fit du droit d’aînesse») le fait passer pour un gourmand qui va jusqu’à brader son droit d’aînesse pour un vulgaire plat de lentilles. Le sens commun lapidaire traduit ainsi cette figure emblématique: «Ventre affamé n’a point d’oreille». La faim engendre la surdité. Elle grignote le bon sens. Les hommes de pouvoir connaissent la valeur de cette sentence et la mettent à profit dans les périodes pré-électorales. Mais ne pourrions-nous pas risquer une autre interprétation qui, elle, permettrait de conclure qu’à cette époque, les lentilles étaient un plat si recherché, si exquis, que cédant à la tentation, l’esprit prompt d’Esaii, il est vrai émoussé par la fatigue, laissa filer la pièce maîtresse de son capital social, comme aurait dit Bourdieu, son droit d’aînesse ?
Une réponse positive réparerait l’injustice millénaire faite par le chroniqueur de la Bible à l’image d’Ésaü. Au lieu de passer pour un léger, un frivole, voire même un irresponsable, Ésaü deviendrait la figure du gourmet. Alors, immédiatement, il faudrait fonder une association des laudateurs d’Esaii, regroupant tout ce que la terre contient de fins connaisseurs, de dégustateurs, de personnes raffinées en matière de boire et de manger. Je tenterais moi-même d’y adhérer, serait-ce en négociant avec Méphistophélès, s’il le faut, malgré ma fureur de vivre, quelques années de mon existence chétive. Trois ans pour l’avocat farci aux crabes; cinq pour le lapin à la moutarde en colère, dix pour le canard à l’orange et, sans doute, une couple supplémentaire, pour la glace antillaise, une glace à la noix de coco.
Certes, à ce rythme, la prédiction de ma mère se réaliserait très vite: «Mon fils, ta bouche te conduira à la tombe!» À cette destinée, aujourd’hui, je ne vois nul inconvénient, pourvu que là bas, au pays, comme on dit si joliment en Haïti, des sans-chapeau, je trouve des mangues pulpeuses à souhait, des huîtres fines claires, du saumon rose du Pacifique, des cailles enrobées dans des feuilles de vigne.
Cette interprétation du célèbre passage de la Bible aurait l’avantage d’aller dans le sens des autres textes du livre saint. Car à vue d’œil, le culinaire est valorisé dans la bible. Je salive à chaque fois que j’ouvre ce recueil de textes. Le nectar de raisin et le miel y coulent en abondance, le pain et le poisson se multiplient, les chevreaux de lait sont très recherches. À quand un Brillât-Savarin ou un Pierre Bourdieu qui nous présenterait la sensibilité culinaire de la Bible?
J’ai peine à croire donc, en me tenant uniquement à la recette de Libby’s ou de Del Monte, qu’Esaü aurait abaissé son goût pour de vulgaires graines rondes au petit salé. Comment Esaü, cet habile chasseur, donc migrant qui avait vu du pays, qui, au dire même de son père, connaissait le gibier et savait le préparer, — de là sa préférence pour ce fils, le gibier étant toujours à son goût, — aurait-il pu être si bête? Isaac l’affectionnait plus que Jacob, le sédentaire, l’homme tranquille, demeurant sous les tentes.
La cuisine transculturelle comme la domination des peuples trouve son origine mythique dans cette histoire d’Esaü et de Jacob.
Et les concordances ne s’arrêtent pas là. Si les Romains n’avaient point été friands de foies d’oies grasses, élevées aux figues, ils n’eussent pas fait venir d’outre-Alpes, les longs troupeaux d’oies gauloises et le Capitole n’eût pas été sauvé. Imaginez un monde où les Arabes ne seraient pas venus en Espagne. Le safran n’aurait pas accommodé tant de plats, du Moyen-âge à nos jours. Pensez une seule seconde: si Marco Polo avait échoué, que serait aujourd’hui la cuisine italienne? Et si mes ancêtres, lors de la grande transhumance, n’avaient point permis l’implantation de la canne à sucre en Amérique?… Je sais ce que cela a coûté de sueur, de larmes et de sang. Mais aujourd’hui, nous n’avons plus besoin de tant de violences pour apprécier les succulences de la terre.

Naguère, McLuhan, dans un de ces raccourcis dont il avait le secret, attirait l’attention sur la fonction unifiante des moyens de communication. Selon lui, le monde était devenu un village global et nous ressemblions à des milliards d’anges dansant sur la tête d’une épingle. Le dessein de l’homme est unitaire; c’est Dieu qui, à Babel, a semé la confusion. Il n’y a pas de meilleur exemple de cette unité qu’une table garnie dans l’attente des convives: l’olive côtoie l’avocat; la semoule, le crabe d’Alaska; les produits de l’érable, ceux de la vigne… Éléments disséminés sur la planète, mais que la main de l’homme a su rassembler en un seul et même lieu: la table. Le métissage culturel passe aussi par le brassage culinaire. Mais se peut-il que l’homme, ce faisant, s’éloigne des origines? Se peut-il qu’à ce jeu, où actuellement il y a tant de perdants, il n’y ait un jour que des gagnants? Cela arrivera si nous parvenons à enlever la gangue obscure qui modèle les rapports des êtres entre eux, pour retrouver les gestes purs; par exemple, enlever au triangle laver-coudre-cuisiner l’épaisse couche de dévouements qui fait qu’on ne perçoit plus ces gestes, aujourd’hui, que comme des tâches subalternes. Il y avait là autrefois une sorte de langage, maintenant perdu, grâce auquel l’être humain pouvait nouer un dialogue avec les éléments premiers du cosmos. Pour ne s’en tenir qu’au feu, doit-on rappeler que le cuit, donc, en dernière instance, le feu, a joué un rôle important dans la sédentarisation des hommes. Cocteau, à qui on demandait ce qu’il emporterait avec lui s’il advenait que le feu brûle sa maison, avait répondu: justement, le feu. L’âtre où il se consume sous la cendre, est l’élément premier des foyers.
La carte culinaire du monde me convainc que les hommes mangent à quelques variantes près, les mêmes aliments de base partout au monde. C’est pour cette raison que je ne suis pas porté à privilégier l’expression d’une cuisine nationale. Dans telle aire géographique, on privilégie le maïs, dans telle autre, la pomme de terre, le riz ou l’arachide. Mais à partir de ces grands ensembles qui font parler de cuisine asiatique, européenne, africaine ou créole, on ne produit pas une connaissance suffisante des goûts de table propres à chaque région. Il n’y a de cuisine que régionale et à la limite, familiale. Encore là faut-il voir comment les êtres humains mangent, selon
qu’ils appartiennent à telle ou telle couche de la société. Prenons un exemple: dans les Antilles, le riz, survalorisé en Haïti est méprisé en Martinique. Ou mieux, le maïs. Dans notre imaginaire haïtien, cet élément a une connotation de misère. Mais il est coté différemment selon qu’il est accompagné de filets de hareng fumé, de lardons ou de lamelles de jambon de Paris. Ma surprise a été grande d’apprendre qu’en Vénétie, la polenta (bouillie de fécule de maïs) servie avec du lapin chasseur, est un festin de roi.
C’est donc dire toute l’importance qu’il faut accorder aux habitudes culinaires. Elles associent, comme aurait écrit Michel de Certeau, l’art de faire au combat pour vivre. Ce qui est la définition même d’une pratique.
Elles peuvent, comme la langue, s’exercer hors de l’espace «maternel», se déterritorialiser, se maquiller même, en prenant des apparences d’emprunts pour vivre en des langues et des territoires étrangers. Nous, migrants, en nous insérant dans d’autres sites géographiques, sociaux et culturels, nous apportons avec nous, parmi les débris, les fragments et les miettes qui restent accolés à nos bagages, nos odeurs, nos épices, nos condiments. Ces auxiliaires du quotidien nous aident à recoudre notre mémoire éclatée, à grignoter, à dents de souris, le nouvel espace de vie, à le modeler au besoin selon nos valeurs, nos rêves et nos aspirations. Nos pratiques de table portent à la fois la marque de notre ressemblance et de notre altérité.

 L’Islam est-il soluble dans la démocratie et le progrès ? C’est la question récurrente que pose le philosophe Claude-Raphaël Samama dans un essai stimulant intitulé : « Perspectives pour les Islams contemporains » publié cette année dans la collection « D’un texte à l’histoire » aux éditions l’Harmattan. Pour y répondre il utilise un comparatisme de bon aloi qui prend appui sur l’anthropologie des civilisations (dont il est un spécialiste) ainsi que sur d’autres disciplines des sciences sociales : l’ethnologie, l’étymologie, l’histoire, la géographie politique et, bien sûr, l’économie… Une approche qui rend concrète la compréhension des enjeux qui se nouent et se dénouent au sein de cette religion pratiquée par le quart de la population mondiale ; soit 1.5 milliard de fidèles. Ces enjeux nous concernent tous autant que nous sommes car ils viennent non seulement faire basculer notre confort occidental mais aussi questionner ce qu’il y a de plus intime en nous : nos croyances. À quoi croyons-nous vraiment ? Sommes-nous si sûrs de notre science et de nos états démocratiques et modernes ? Mais qu’est-ce que croire ? Et quelle liberté laisse la croyance ou la non-croyance à l’individu ?
L’Islam est-il soluble dans la démocratie et le progrès ? C’est la question récurrente que pose le philosophe Claude-Raphaël Samama dans un essai stimulant intitulé : « Perspectives pour les Islams contemporains » publié cette année dans la collection « D’un texte à l’histoire » aux éditions l’Harmattan. Pour y répondre il utilise un comparatisme de bon aloi qui prend appui sur l’anthropologie des civilisations (dont il est un spécialiste) ainsi que sur d’autres disciplines des sciences sociales : l’ethnologie, l’étymologie, l’histoire, la géographie politique et, bien sûr, l’économie… Une approche qui rend concrète la compréhension des enjeux qui se nouent et se dénouent au sein de cette religion pratiquée par le quart de la population mondiale ; soit 1.5 milliard de fidèles. Ces enjeux nous concernent tous autant que nous sommes car ils viennent non seulement faire basculer notre confort occidental mais aussi questionner ce qu’il y a de plus intime en nous : nos croyances. À quoi croyons-nous vraiment ? Sommes-nous si sûrs de notre science et de nos états démocratiques et modernes ? Mais qu’est-ce que croire ? Et quelle liberté laisse la croyance ou la non-croyance à l’individu ?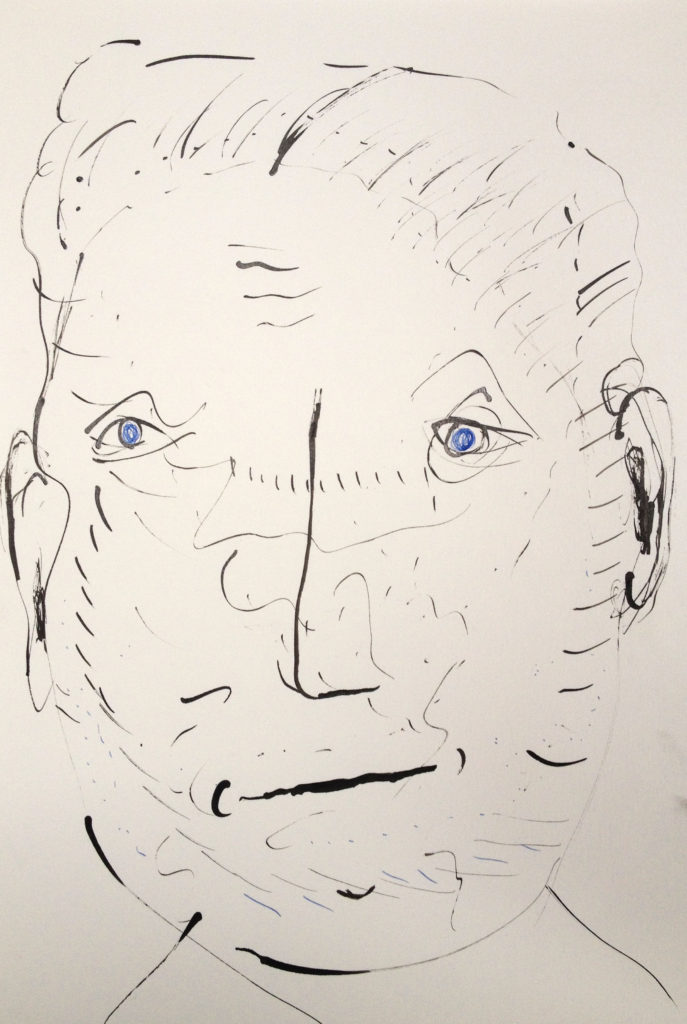 Entre culture méditerranéenne et américanisation : une approche comparée des valeurs masculines et féminines dans la société civile italienne. Quelques observations préliminaires
Entre culture méditerranéenne et américanisation : une approche comparée des valeurs masculines et féminines dans la société civile italienne. Quelques observations préliminaires


 Mais s’il nous est venu le désir d’en reparler aujourd’hui, ce n’est pas seulement pour souligner une fois encore les qualités de ce spectacle… Un « détail » nous a frappés, qui résonne, de manière troublante, avec notre actualité. Paris, seconde moitié des années 30: Irène est en train de lire Gringoire, dont le public peut voir le titre qui s’étale en première page, chassez les étrangers (la phrase revient par la suite). Comme on sait, ce journal politique, littéraire et satirique, dès le début des années 30, alimente la xénophobie qui ne fera que croître par la suite en France. La haine des étrangers se conjugue avec une violente campagne antisémite: le complotisme en vogue à cette époque reproche aux Juifs de vouloir la guerre, de propager les idées communistes ou à l’inverse d’accumuler la richesse au détriment du peuple, de favoriser l’immigration génératrice de désordres. Nous ne savons que trop à quelle tragédie ce délire a conduit l’Europe (Gringoire a aussi publié de nombreux récits d’Irène Némirovsky, les derniers sous un pseudonyme: mais cela ne l’a pas protégée de la déportation et de la mort, et lui a même valu, auprès de ses détracteurs, l’absurde et injuste étiquette de « Juive qui hait les Juifs »)
Mais s’il nous est venu le désir d’en reparler aujourd’hui, ce n’est pas seulement pour souligner une fois encore les qualités de ce spectacle… Un « détail » nous a frappés, qui résonne, de manière troublante, avec notre actualité. Paris, seconde moitié des années 30: Irène est en train de lire Gringoire, dont le public peut voir le titre qui s’étale en première page, chassez les étrangers (la phrase revient par la suite). Comme on sait, ce journal politique, littéraire et satirique, dès le début des années 30, alimente la xénophobie qui ne fera que croître par la suite en France. La haine des étrangers se conjugue avec une violente campagne antisémite: le complotisme en vogue à cette époque reproche aux Juifs de vouloir la guerre, de propager les idées communistes ou à l’inverse d’accumuler la richesse au détriment du peuple, de favoriser l’immigration génératrice de désordres. Nous ne savons que trop à quelle tragédie ce délire a conduit l’Europe (Gringoire a aussi publié de nombreux récits d’Irène Némirovsky, les derniers sous un pseudonyme: mais cela ne l’a pas protégée de la déportation et de la mort, et lui a même valu, auprès de ses détracteurs, l’absurde et injuste étiquette de « Juive qui hait les Juifs »)