Sophie Jankélévitch
Giuseppe Rensi n’est sans doute pas le philosophe italien le mieux connu en France. Néanmoins, grâce aux éditions Allia, plusieurs essais de ce penseur sceptique, profondément marqué par Leopardi, sont aujourd’hui disponibles en français.

Contre le travail est la seconde partie d’un livre intitulé L’Irrazionale, il Lavoro, l’Amore, paru à Milan en 1923 et republié en 2012 sous le titre Contro il lavoro. En le lisant on pense à Lafargue (Le droit à la paresse (1883), à Malevitch (La paresse comme vérité effective de l’homme, 1921), à Russell (Eloge de l’oisiveté,1932), sans parler bien sûr des philosophes cités par Rensi lui-même : Aristote, Horace, Cicéron, Sénèque, Epictète, Schopenhauer, et bien d’autres. Contre le travail occupe cependant une place tout à fait à part dans ce courant de pensée. En effet, la spécificité des réflexions de Rensi réside moins dans la condamnation du travail que dans la manière dont il dégage la dimension tragique du problème : « tous les hommes haïssent le travail », mais il n’y a pas d’issue, pas d’espoir. Le travail est à la fois nécessaire et impossible, « tant du point de vue moral que du point de vue économique et social ». L’impossibilité radicale de trouver une solution est d’ailleurs le fil directeur du texte ; avant même de clarifier le concept de travail (en l’opposant assez classiquement au jeu), l’auteur en souligne les contradictions internes.
L’opposition du jeu et du travail n’est pas nouvelle, mais elle est nécessaire à l’argumentation. L’activité ludique est à elle-même sa propre fin : en ce sens, elle ne se réduit pas au jeu proprement dit, elle englobe la production artistique, le « travail » du scientifique, du philosophe, du poète ‒ dès lors que ces activités ne sont pas déterminées par la recherche du gain ou de la gloire ‒ mais aussi la simple flânerie, la rêverie, la conversation… D’une façon générale, est ludique ce qui est gratuit, c’est-à-dire non dicté par la poursuite d’un intérêt extérieur ; le travail, au contraire, est accompli uniquement en vue des résultats qu’on en attend. Cette opposition du jeu et du travail est aussi, on le voit, celle de deux relations à la temporalité : l’une complètement ramassée dans le présent, l’autre toute entière tendue vers le futur. En effet, quand l’activité n’est qu’un moyen d’atteindre des objectifs, le présent ne peut être vécu pour lui-même, car le désir d’accumulation, l’attente des résultats projettent toujours plus loin, dans un avenir incertain. Dans l’activité ludique, l’effort est mû par le seul désir de l’agent, il se déploie suivant un élan spontané, et il est en lui-même source de plaisir ; dans le travail il est fourni sous la pression d’une contrainte extérieure. « Jeu » signifie autonomie et liberté, « travail » hétéronomie et esclavage ; entre travail et esclavage la différence est seulement de degré, non de nature, elle réside dans la quantité de temps – minime ou inexistante dans le cas de l’esclavage proprement dit – laissée au travailleur pour qu’il en dispose à sa guise. C’est pourquoi le travail est en soi un obstacle à la réalisation de la nature humaine. L’homme n’est pleinement homme que lorsqu’il joue, et cette idée, nous dit Rensi, est loin d’être « le fruit malsain de l’inertie et de la mollesse orientale »… Ici, c’est aux personnages des romans d’Albert Cossery (notamment Les fainéants dans la vallée fertile) qu’on pense. Aux antipodes de l’ « esprit du capitalisme », ce produit de l’éthique protestante analysée par Max Weber au tout début du XXe siècle, les fainéants, mendiants et autres saltimbanques déambulant dans les rues du Caire mettent en pratique les préceptes d’Epictète ‒ un des philosophes avec lesquels Rensi a sans doute le plus d’affinités : riches ou pauvres, indifférents aux biens matériels en eux-mêmes, cultivant l’oisiveté et la contemplation, ils jouent leur rôle dans le théâtre de la vie. A la morale du travail, qui condamne la paresse comme un vice, s’oppose ainsi, dans le sillage des Stoïciens, une morale supérieure, fondée sur la conception de la vie elle-même comme un jeu.
Mais pourquoi le travail est-il un problème insoluble? Parce que deux injonctions contradictoires s’y combattent : d’un côté il se présente comme un devoir moral, en tant qu’il permet le passage de la vie animale à la vie humaine et qu’il est la condition de possibilité du développement spirituel; de l’autre, c’est un devoir non moins impératif d’y échapper, parce qu’il interdit la jouissance de ce qu’il est censé servir à atteindre. Mais pour y échapper il faut pouvoir compter sur ses fruits, c’est-à-dire s’en décharger sur d’autres ; le non-travail des uns implique donc le travail des autres, qui sont alors privés de la possibilité de vivre une vie pleinement humaine. On voit bien où se situe la contradiction : juste et légitime d’un certain point de vue, l’effort pour se délivrer du travail est injuste et illégitime du point de vue de ceux sur qui en retombe le poids. Dans la question du travail s’affrontent ainsi des exigences incompatibles entre elles, si bien qu’une solution apparaissant juste au regard d’une de ces exigences s’avérerait nécessairement injuste au regard des autres.
La seule forme de production dotée de quelque valeur spirituelle et susceptible de donner au travailleur le sentiment d’être un créateur est l’artisanat. Mais cette forme de travail – dans laquelle l’activité est en elle-même source de plaisir – a disparu avec le développement urbain et le travail de masse en usine nécessité par l’intensification de la vie sociale. Ce travail en usine est indispensable au maintien de la civilisation car il est le seul à pouvoir produire la quantité de biens nécessaire à une vie vraiment humaine (étant donné l’accroissement de la population et la taille des sociétés contemporaines), mais en même temps il est la négation d’une telle vie et ne peut être vécu autrement que comme un esclavage, un obstacle à tout épanouissement spirituel. La pensée de Rensi a souvent des accents anti-capitalistes, voire même nostalgiques à certains endroits, quand il oppose aux villages et aux petites communautés d’autrefois cette « monstruosité de l’époque moderne » qu’est la grande ville; au fil de la lecture, des images de la Metropolis de Fritz Lang ou des Temps Modernes de Chaplin viennent à l’esprit. Même si le terme d’aliénation n’est jamais utilisé, c’est bien de cela qu’il s’agit lorsque l’auteur évoque la condition de l’ouvrier d’usine. Mais encore une fois, c’est le travail en soi qui à ses yeux est absurde et contraire à la dignité humaine. A l’époque où il publie son essai, les vertus du travail sont exaltées par le fascisme, qui triomphe en Italie et dont le philosophe fut un farouche opposant, mais aussi par le bolchévisme au pouvoir en Russie depuis la Révolution de 1917. Mais aux yeux de Rensi une organisation sociale octroyant aux travailleurs la propriété des moyens de production ne change rien à la nature profondément avilissante du travail. Pour les ouvriers, être les maîtres des machines sur lesquelles ils travaillent ne supprime en rien leur dépendance à l’égard de ces machines. C’est pourquoi le philosophe n’a pas d’illusions sur les révolutions, qu’il considère comme vaines.
S’il n’y a pas d’issue, c’est parce que la seule « solution » serait l’abolition pure et simple du travail : utopie à laquelle Marx et Engels « auraient dû logiquement parvenir pour remédier aux maux qu’ils dénoncent » dans le Manifeste. Nous savons déjà pourquoi il s’agit en effet d’une utopie, puisque le travail est à la fois impossible et nécessaire. Mais Rensi ne prône pas non plus le retour à l’artisanat et à une forme d’économie « villageoise », incapable selon lui d’assurer les moyens d’une vie « véritablement humaine » dans les conditions d’aujourd’hui. En réalité il ne prône rien, car il ne croit pas en la possibilité de résoudre la contradiction.
Ce scepticisme radical s’appuie sur une philosophie du droit inspirée du juriste allemand Rudolph von Jhering (1818-1892), auquel Rensi se réfère à plusieurs reprises. Il n’existe pas de droit naturel, pas de norme universelle et objective du juste, mais seulement une multiplicité de points de vue, tous également dépourvus de fondement, qui se combattent mutuellement. Aucune idée du juste en soi ne peut orienter l’action vers une solution qui serait la bonne, il n’y a pas de devoir-être à la lumière duquel on puisse concevoir une amélioration de ce qui est. L’idée même de progrès se trouve ainsi invalidée. Le droit, loin de s’opposer à la force, en est issu ; il se réduit au sentiment subjectif d’avoir raison, qui parvient à l’emporter sur les sentiments opposés. En d’autres termes, c’est le point de vue du groupe le plus fort, capable par conséquent de s’imposer aux autres, qui devient droit. Et le droit change quand change le rapport de forces.
Pour conclure, on peut quand même se demander si les sociétés d’Indiens du Brésil étudiées par Pierre Clastres n’avaient pas trouvé la clef du problème (même si elles étaient très petites par rapport aux sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd’hui)… Construites pour « éviter » que l’Etat n’apparaisse – et avec lui, la division entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent – elles sont strictement égalitaires : tous « travaillent » pour produire les biens nécessaires à la vie et rien de plus ; la satisfaction des besoins (pour la plupart les besoins énergétiques) est la finalité exclusive de l’activité de production, et détermine seule la quantité de temps qu’il faut y consacrer. Très peu d’heures quotidiennes suffisant pour cela, le reste du temps est disponible pour les fêtes, le jeu, l’oisiveté… Chacun est maître de son activité, personne ne produit au bénéfice d’un autre, il n y a donc pas à proprement parler de « travail » ; le concept de travail, en effet, désigne avant tout une activité de production visant à satisfaire les besoins des autres. Ce que nous appelons travail est inséparable d’une société hiérarchisée, dans laquelle ceux qui détiennent le pouvoir commandent aux autres, qui se soumettent. Pour Clastres, c’est la domination qui est à l’origine du travail aliéné, c’est-à-dire en fait du travail tout court…
Un autre combat se dessine alors peut-être pour sortir des apories soulevées par le philosophe italien : refuser d’obéir, changer radicalement de mode de vie, repenser complètement la notion de besoin, s’affranchir enfin d’une morale qui valorise exclusivement le faire – dans le sens de produire – au détriment de l’« être »… Car il y a quand même une certitude : « on ne veut plus travailler » !





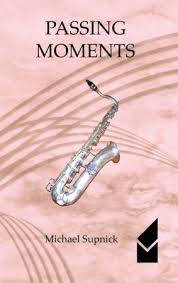 Connaissez-vous la Gennet Record Company, Richmond, Indiana, Bix Beiderbecke, les flapper girls, le lindy hop, la shim sham ? Non ?! Ce sont pourtant les lieux, les personnages et les danses qui ont accompagné la légende du Jazz. Et c’est cette histoire passionnante que nous dévoile en italien Michael Supnick dans ce roman surprenant dont le titre, tiré sans doute d’une pièce de jazz, est déjà tout un programme : Passing moments. Tout commence par le plus banal des hasards : l’acquisition d’un vieux saxophone acheté sur Internet. Mais l’année de sa fabrication -1912- intrigue ce jazzman accompli, américain de naissance et italien d’adoption, qui a plus de 70 enregistrements à son compteur. Se pourrait-il que ce saxophone ait été le témoin de l’histoire du jazz ? Il n’en fallait pas plus pour allumer l’imagination de Supnick qui aussitôt s’enquiert du premier propriétaire de l’instrument. Les quelques éléments glanés lui suffisent pour brosser la trame d’une histoire qui se révèle par petites touches, comme un secret de famille. Et qui pour lever ce secret sinon un jeune garçon de huit ans dont la curiosité l’amène à découvrir dans le grenier de la maison un vieille malle obstinément fermée. Que contient-elle et pourquoi la valise à ses côtes, remplie de robes de bal des années trente disparaît-elle aussitôt que Jimmy, c’est le nom du petit garçon, en parle à sa mère ? Nous sommes le 29 mars 1967 , à Richmond , Indiana, au cœur de la Bible Belt mais qui fut aussi un temps le cœur vibrant des Roaring Twenties : les années 20 américaines. Pour la raconter Supnick construira deux récits en parallèle : le premier est celle de l’histoire du jazz qui va de 1923 à la fin des années 60 ; le second part justement de cette période, celle de la redécouverte, jusqu’ à sa reconnaissance dans les années 80. Cette trame alternera et finira par se confondre comme les branches du caducée , le 13 mai 1980 dans un chapitre conclusif qui s’intitule justement « La réhabilitation ». Car cette entreprise est bien celle de la réhabilitation de la mémoire occultée où Jimmy découvrira la véritable histoire de son grand-père paternel, Boogie Windham, jazzman à ses heures, mais surtout de son grand oncle Windy, petit génie du saxophone et propriétaire de l’instrument. C’est à travers lui, sa vie, ses espoirs mais aussi ses déconvenues que le narrateur va nous faire découvrir le jazz. Car Windy serait ce qu’on pourrait appeler « un petit maître » ; il aura joué avec les plus grands sans toutefois obtenir son moment de gloire ; moment qui lui sera volé… par un train dont le sifflet s’invite au beau milieu de son solo sur le point d’être gravé. Car le mythique studio d’enregistrement de Richmond se trouvait tout près de la gare de train, (directement connecté avec la Nouvelle Orléans par où remontaient le contingent de jazzmen noirs invités à se faire voir ailleurs par le nouveau maire d’alors). Et les prises d’enregistrement étaient calculées en fonction des horaires des trains.
Connaissez-vous la Gennet Record Company, Richmond, Indiana, Bix Beiderbecke, les flapper girls, le lindy hop, la shim sham ? Non ?! Ce sont pourtant les lieux, les personnages et les danses qui ont accompagné la légende du Jazz. Et c’est cette histoire passionnante que nous dévoile en italien Michael Supnick dans ce roman surprenant dont le titre, tiré sans doute d’une pièce de jazz, est déjà tout un programme : Passing moments. Tout commence par le plus banal des hasards : l’acquisition d’un vieux saxophone acheté sur Internet. Mais l’année de sa fabrication -1912- intrigue ce jazzman accompli, américain de naissance et italien d’adoption, qui a plus de 70 enregistrements à son compteur. Se pourrait-il que ce saxophone ait été le témoin de l’histoire du jazz ? Il n’en fallait pas plus pour allumer l’imagination de Supnick qui aussitôt s’enquiert du premier propriétaire de l’instrument. Les quelques éléments glanés lui suffisent pour brosser la trame d’une histoire qui se révèle par petites touches, comme un secret de famille. Et qui pour lever ce secret sinon un jeune garçon de huit ans dont la curiosité l’amène à découvrir dans le grenier de la maison un vieille malle obstinément fermée. Que contient-elle et pourquoi la valise à ses côtes, remplie de robes de bal des années trente disparaît-elle aussitôt que Jimmy, c’est le nom du petit garçon, en parle à sa mère ? Nous sommes le 29 mars 1967 , à Richmond , Indiana, au cœur de la Bible Belt mais qui fut aussi un temps le cœur vibrant des Roaring Twenties : les années 20 américaines. Pour la raconter Supnick construira deux récits en parallèle : le premier est celle de l’histoire du jazz qui va de 1923 à la fin des années 60 ; le second part justement de cette période, celle de la redécouverte, jusqu’ à sa reconnaissance dans les années 80. Cette trame alternera et finira par se confondre comme les branches du caducée , le 13 mai 1980 dans un chapitre conclusif qui s’intitule justement « La réhabilitation ». Car cette entreprise est bien celle de la réhabilitation de la mémoire occultée où Jimmy découvrira la véritable histoire de son grand-père paternel, Boogie Windham, jazzman à ses heures, mais surtout de son grand oncle Windy, petit génie du saxophone et propriétaire de l’instrument. C’est à travers lui, sa vie, ses espoirs mais aussi ses déconvenues que le narrateur va nous faire découvrir le jazz. Car Windy serait ce qu’on pourrait appeler « un petit maître » ; il aura joué avec les plus grands sans toutefois obtenir son moment de gloire ; moment qui lui sera volé… par un train dont le sifflet s’invite au beau milieu de son solo sur le point d’être gravé. Car le mythique studio d’enregistrement de Richmond se trouvait tout près de la gare de train, (directement connecté avec la Nouvelle Orléans par où remontaient le contingent de jazzmen noirs invités à se faire voir ailleurs par le nouveau maire d’alors). Et les prises d’enregistrement étaient calculées en fonction des horaires des trains.