Fulvio Caccia
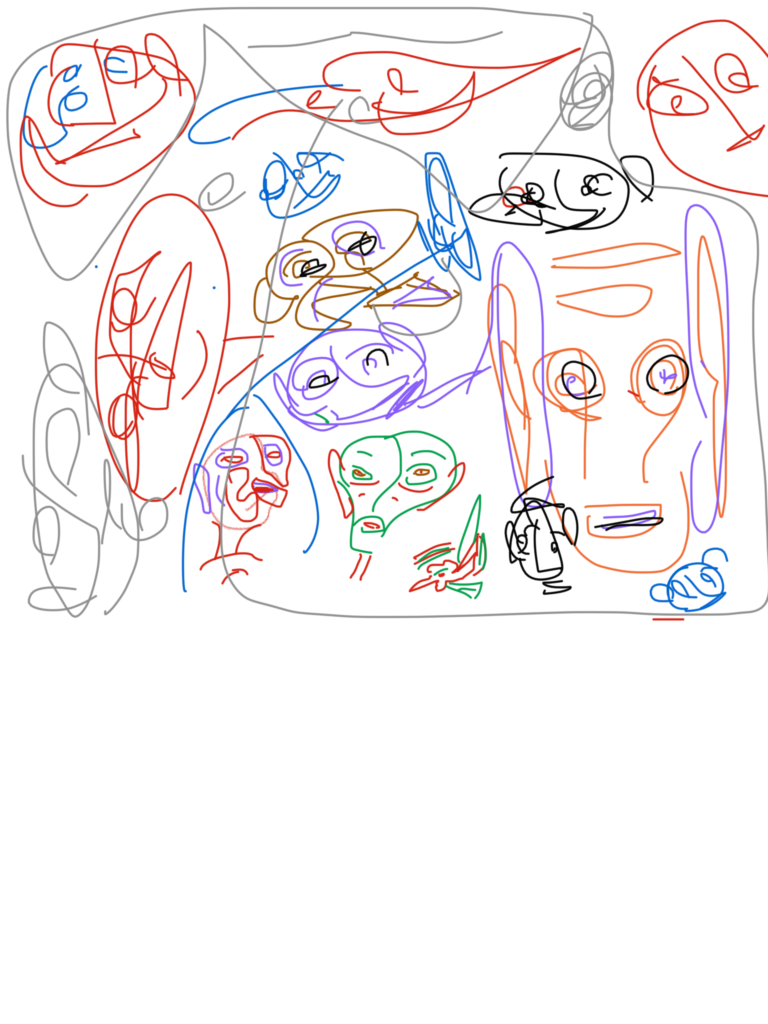 Ce texte est celui de l’allocution d’ouverture du colloque “1985-2005 : vingt ans d’écriture migrante au Québec. Les voies d’une herméneutique”, ( Marc Arino et Marie-Lyne Piccione) Presses universitaires de Bordeaux, 2007.
Ce texte est celui de l’allocution d’ouverture du colloque “1985-2005 : vingt ans d’écriture migrante au Québec. Les voies d’une herméneutique”, ( Marc Arino et Marie-Lyne Piccione) Presses universitaires de Bordeaux, 2007.
Dans son plus récent essai, le romancier tchèque Milan Kundera nous rappelle qu’il y a deux contextes élémentaires pour situer et apprécier une oeuvre d’art : ou bien l’histoire de sa nation appelée « petit contexte » ou bien l’histoire surpra nationale de son art : « le grand contexte ». Contrairement à la musique, la littérature est davantage liée à l’histoire de la nation qui la produit à cause de la force centripète de la langue qui maintient les productions littéraires à l’intérieur de son territoire. Hors de la langue, point de salut. C’est pourquoi l’histoire mondiale de la littérature brille par son absence. Kundera attribue à ce monolinguisme « l’irréparable échec intellectuel de l’Europe».
Ce constat sévère, formulé par l’un des romanciers les plus importants de notre époque, jette une lumière inédite sur la valeur heuristique de la notion que nous nous apprêtons à discuter : les écritures migrantes.
L’hypothèse que je souhaite exposer et défendre dans ces pages est la suivante. Les écritures migrantes ont été et demeurent une tentative pour inscrire les jeunes littératures néocoloniales dans le « grand contexte ». Telle est, à mes yeux, sa seule et unique valeur heuristique. C’est pourquoi envisager les écritures migrantes seulement dans le « petit contexte » n’a strictement aucun sens. Ou s’il y en a un, c’est plutôt celui de mesurer leur degré de naturalisation au sein des nouvelles littératures nationales, autrement dit, leur degré d’idéologisation.
Vous pardonnerez la brutalité de cette affirmation qui va peut-être à rebrousse-poil des idées reçues et des pratiques en ce domaine. Mais avec ses vingt ans, et toutes ses dents ! Les écritures migrantes ainsi que les appareils critiques qui les soutiennent sont parvenus, me semble-t-il, à l’âge adulte et à ce titre peuvent affronter quelques vérités qui permettront de comprendre pourquoi ce terme est venu à désigner le contraire de ce qu’il décrivait au milieu des années 80.
Une genèse en trois actes
Revenons en arrière, si vous voulez bien ; soit au moment où cette notion est utilisée pour la première fois au sein de la littérature haïtienne en diaspora. Le premier acte débute durant les années 80, alors que les écrivains haïtiens prennent la mesure de leur « arrachement » (Dorsinville) et de la manière dont l’exil a transformé leur rapport à l’écriture. Ecartelés entre deux continents et quatre pays d’accueil, ceux-ci cherchent à penser les conditions d’une littérature nationale hors de son territoire originel. Comment en effet être reconnus par l’institution littéraire dès lors que celle-ci appartient à d’autres dispositifs nationaux et visent donc des lectorats «étrangers » ? Tel est en effet l’équation complexe à laquelle cherche à répondre cette génération née pour l’essentiel entre les deux guerres.
L’équation que les écrivains haïtiens doivent résoudre, comporte deux inconnues : l’une est formelle, l’autre est thématique et renvoie à la filiation. D’abord, comment dépasser l’imitation, le mimétisme de leurs aînés avec l’épineux problème du lectorat et du rapport entre langue vernaculaire et langue véhiculaire. Ensuite, quelle distance prendre avec la négritude et l’indigénisme des Césaire, Senghor, Dumas qui les rattacheraient trop exclusivement à leur continent d’origine en mettant sous le boisseau leur américanité fondatrice et donc leur métissage ?
« A l’heure actuelle, il semble que nous soyons arrivés dans les nouvelles productions caraïbennes à ce que j’appellerais : « l’époque du dépassement, une écriture métisse ». Les derniers textes m’apparaissent non plus répondre à la première question de Kant -qui sommes-nous ? Mais évoluent vers un : que pouvons-nous faire ? Que pouvons-nous espérer ? » Vous aurez reconnu le propos d’Émile Ollivier qui en souhaitant le dépassement de la question identitaire, problématique moderne ô combien, introduit un nouveau terme : l’écriture métisse, l’écriture migrante.
Cette réflexion, comme bien d’autre font partie d’un recueil d’entretiens passionnants intitulé le pouvoir des mots, les maux du pouvoir : des romanciers haïtien en exil que Jean Jonassaint a consacré à cette génération en 1986. S’il faut donc trouver une origine aux « écritures migrantes», c’est bien dans ce livre-jalon qu’il faut la situer. C’est là dans la bouche d’Emile Ollivier mais surtout dans l’échange entre deux écrivains que jaillit cette nation comme on frappe deux pierres de silex. Si elle se manifeste de manière suffisante et nécessaire en tant que théorie du métissage et stratégie du dépassement, les écritures migrantes ne concernent dans un premier temps que les seules écritures caraïbéennes.
Le second acte advient lorsque leur compatriote Robert Berrouet-Oriol décide d’alerter l’institution littéraire québécoise qui était restée muette à ce propos. Son article, intitulé « Effet d’exil », sera publié dans le dossier spécial «culture politique au Québec» de la revue transculturelle Vice versa de Montréal dont j’étais le rédacteur en chef et membre du collectif fondateur. L’agacement de Berrouet-Oriol se comprenait d’autant plus que l’ouverture québécoise était d’emblée saluée par des auteurs comme René Depestre qui voyaient le Québec comme « un oasis» de liberté et de réflexion pour ses compatriotes exilés.
L’article fit mouche. Car son auteur avait compris que cette demande de reconnaissance institutionnelle ne concernait pas seulement les romanciers de la diaspora haïtienne mais aussi la littérature québécoise. L’écrivain l’affirmera d’ailleurs en lettres capitales : “ l’enjeu culturel et politique” ne résidait pas seulement dans “la CAPACITÉ du champs littéraire à accueillir les voix venues d’ailleurs mais surtout d’assumer à visière levée qu’elle est travaillée transversalement par des voix métisses”. On ne saurait être plus clair.
Devant ce pressant appel du pied, l’institution littéraire répondra par l’entremise de Pierre Nepveu, l’un de ses plus éloquents représentants. Poète et écrivain lui-même, auteurs d’essais remarqués, Nepveu sera particulièrement sensible à cette expression créatrice qui se manifestait au sein d’une littérature postcoloniale désireuse de s’émanciper de la tutelle de la tradition.
“Ecriture migrante de préférence à “immigrante” ce dernier terme me paraissait un peu trop restrictif mettant l’accent sur l’expérience et la réalité même de l’immigration, de l’arrivée au pays et de sa difficile habitation (ce que de nombreux textes racontent ou évoquent effectivement), alors que migrante insiste davantage sur le mouvement, la dérive, les croisements multiples que suscite l’expérience de l’exil. “Immigrante “ est un mot à teneur socio-culturelle, alors que “migrante “ a l’avantage de pointer déjà vers une pratique esthétique, dimension évidemment fondamentale pour la littérature actuelle.»
Cette note infrapaginale dans L’Ecologie du réel, publié en 1988 constitue le 3e acte de la mise en orbite des écritures migrantes. En lui consacrant dans le même ouvrage un chapitre entier, l’écrivain universitaire ouvre la donne avec les mêmes préoccupations de problématiser la littérature québécoise en dehors des cadres nationaux. Par cet essai qui fera date, l’institution signait non seulement un certificat de naturalisation pour l’œuvre des écrivains haïtiens mais, mutatis mutandis, accordait à l’ensemble des écrivains d’origine étrangère une opportunité inédite, du moins en théorie, de pouvoir confronter leur travail avec celui des autochtones à l’aulne de la pratique esthétique, du style.
Homologies
Que cette reconnaissance de la multiappartenance provienne d’une culture elle-même néocoloniale et en partie métissée, ne doit pas surprendre au demeurant. Il y avait en quelque sorte homologie entre le projet de dépassement identitaire porté par les écrivains haïtiens et celui des écrivains québécois les plus progressistes. Cette homologie tenait essentiellement aux mêmes questionnements sur le matériau de la langue et sur ses niveaux (joual/ langue de culture) et la même rapport au modèle hexagonal.
Plus consciente de sa fragilité, moins bien dotée que ses modèles (français et anglais) mais plus que sa consoeur haïtienne, la littérature du Québec était particulièrement bien préparée à recevoir et à incuber une notion qui lui permettra du coup d’affirmer une universalité qui ne pouvait prendre appui sur la centralité de la langue et le poids démographique de ses locuteurs mais au contraire sur sa faiblesse et sur sa périphérie.
L’homologie était également au rendez-vous auprès des écrivains anglo-montréalais qui, à la suite du mouvement McGill français, étaient soucieux de prendre leurs distances avec leur élite politique trop inféodée au modèle libéral. Il en est agi de même pour les écrivains issus des immigrations et notamment de l’immigration italienne. Quoique plus récents, ceux-ci devaient aussi se confronter au problème de la langue et aux conditions éthiques et esthétiques du métissage tels qu’elles avaient été esquissées quelques cinquante ans plus tôt par le cubain Fernando Ortiz.
Cet auteur voulait alors définir l’identité de son île natale à travers son quadruple héritage. Pour Ortiz, la transculturation est « vécue par l’immigrant, déraciné de sa terre natale, dans son double mouvement de mésdaptation et de réadaptation, de déculturation ou exculturation et d’acculturation ou inculturation pour tendre enfin vers la synthèse de la transculturation». Cette définition avec son mouvement hégélien correspondait mieux, selon nous du collectif Vice versa, au fondement de la culture politique en Amérique avec ses métissages ethniques et culturels.
A ce moment, haïtianité, québecité, italianité, anglo-montréalité convergeaient dans cette quête multiple et fiévreuse vers la modernité/postmodernité d’une littérature universelle selon les vœux même qu’un Goethe formulait jadis. « La littérature nationale, affirmait-il, ne représente plus grand-chose aujourd’hui, nous entrons dans l’ère de la littérature mondiale ( die Weltliteratur) et il appartient à chacun d’entre nous d’en accélérer cette évolution ». Le Montréal de cette période à été sans doute l’éphémère relais, l’accélérateur de cette littérature mondiale en gestation dont l’obsédant fantasme traverse l’histoire des lettres occidentales comme les particules d’antimatière surgissent, un bref instant, du cyclotron. Moment de grâce durant lequel la coïncidence de cette quadruple homologie retourna l’impossibilité kafkaïenne de la littérature haïtienne (impossibilité d’écrire en français, impossibilité d’écrire en créole, impossibilité d’écrire autrement) pour en faire le nouvel avatar paradigmatique du « grand contexte ».
Mais, chassez le naturel, il revient au galop. S’il y a eu ouverture et, ceci est incontestable, il n’en demeure pas moins qu’après vingt ans, plusieurs dizaines de titres, des prix prestigieux, une polémique et quelques anthologies, force est de constater que la réception des écritures migrantes est restée cantonnée pour l’essentiel au « petit contexte » recouvrant précisément «la teneur socio-culturelle» qu’il était censé dépasser.
Pourquoi donc cet échec ? Pourquoi cette impasse sur la pratique esthétique ? Sur le style ? Il y a plusieurs raisons à cela. Je dirai d’abord que ce retournement est une constante dans la genèse des littératures et à fortiori des sociétés en mutation. Que ce soit dans la société italienne du XIVe siècle, de la France révolutionnaire, de la société allemande préromantique… s’ouvre alors « une fenêtre d’opportunité » dans laquelle, l’espace d’un bref moment, se rejoue le rapport à l’autre et à sa modernité.
C’est justement à cette occasion, dans ce kairos que Goethe avait formulé les contours de la Wieliteratur qui était lui-même en résonance, 500 ans plus tôt avec le vulgaire illustre théorisé par Dante. Pour l’auteur de la Divine Comédie « la langue illustre », la langue de la poésie, n’est pas une langue nationale, mais une langue étrangère. Elle est « partout et nulle part ». « Nous disons que le vulgaire illustre, cardinal, aulique et courtois d’Italie est celui qui est propre à toutes les cités mais n’appartient à aucune et par lequel tous les vulgaires des Italiens sont mesurés, pesés et comparés. » C’est d’emblée une langue déterritorialisée. Et l’on voit ainsi fonctionner dans toute sa splendeur la mécanique binaire par laquelle l’esprit humain cherche à pallier son manque, son sentiment de perte, de séparation. Je fais référence aux travaux de Jacques Lacan sur le Nom du Père qui préside à l’apprentissage du langage et de la culture.
On sait que le nourrisson se trouve dans une relation fusionnelle avec le monde qui l’entoure en général et à sa mère en particulier. La mère est l’unique objet de son désir. C’est le surgissement du père et, plus particulièrement, de son nom qui lui signifie que sa mère est aussi l’objet de désir d’un tiers et qu’il devra apprendre à la partager. Cette frustration s’accompagnera de la conscience qu’il est un être séparé, distinct du corps de sa mère ; bref qu’il est incomplet. Et c’est précisément cette frustration, cette angoisse qui engagera l’enfant sur le chemin du langage et de la culture. Lacan nous apprend que le Nom du Père a justement pour fonction de séparer l’enfant du désir de sa mère en l’obligeant à se relier à elle symboliquement par la langue afin de devenir autonome par l’acquisition de la parole.
Ce qui se passe chez le nourrisson n’est pas étranger au développement identitaire des peuples. En séparant et en reliant, en se territorialisant en se déterritorialisant, comme diraient Deleuze et Guattari, l’homme et, à fortiori, l’écrivain instaure une rupture et invente justement du nouveau. Nouveau qu’il oubliera dans la foulée pour mieux se rassurer. Comme l’enfant qui, étonné de faire ses premiers pas, se laisse choir pour sentir la rassurante force de la terre. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : de la terre-mère familière dont l’horizon est sa frontière. En deçà nous sommes dans le périmètre du connu, au-delà nous sommes dans l’inconnu qui nous intrigue d’autant plus que nous savons pertinemment que c’est par là justement que nous trouverons notre salut, qu’arrivera l’Autre.
La Poiêsis, l’autre monde
Cet au-delà de la frontière instille un autre temps, ce que Valery appelle par un curieux renversement « le petit temps ». Ce petit temps, dit-il «donne des lueurs d’un autre système ou « monde » que ne peut éclairer une clarté durable». Ce monde particulier est bien celui de la poiêsis, à la lettre « ce que l’on fait » et qui dans son accomplissement même nous est inconnu.
C’est pourquoi celle-ci fonde la modernité qui n’est que l’incessant travail, au sens obstétrique du terme, des formes anciennes -la tradition- accouchant des formes nouvelles. Cela ne va pas sans douleur, ni violence. Mais tel est bien ainsi que la naissance advient dans ce quelle engendre aussi notre appartenance à la nation : le lieu où l’on naît. C’est aussi dans cette perspective qu’il convient de lire l’injonction rimbaldienne. « Il faut être résolument moderne ». Or, pour s’accomplir, cette modernité ne requiert nullement le « petit contexte », c’est-à-dire l’histoire socioculturelle d’un peuple mais exige bel et bien le « grand contexte » qui est , rappelons-le, l’histoire des formes littéraires.
C’est seulement en les confrontant aux œuvres antérieures que les productions issues des écritures migrantes, révèleront ce qu’il y a de singulier, d’original, de nouveau. C’est de la sorte que l’on peut légitimement mesurer la véritable valeur d’une œuvre. Mais cette approche « comparatiste » n’est-ce pas là le processus même de toute création ? Comparaison. Imitation. Assimilation « Imitant les meilleurs auteurs grecs, nous rappelle Joachim du Bellay, se transformant en eux, les dévorant, et après les avoir bien digérés, les convertissant en sang et nourriture, se proposant, chacun selon son naturel et l’argument qu’il veut élire, le meilleur auteur, dont ils observaient diligemment les plus rares et exquises vertus… ».Voilà qui jette aussi une lumière sur le processus identitaire. L’identité est plurielle et ne s’unifie qu’à travers la soumission volontaire à la Loi. Or cette loi est précisément celle de l’étranger, du barbare qui est aussi la loi du style.
La loi de l’étranger : la loi de l’interdit de l’inceste
Dans un livre magistral, Robert Richard explore les fondements de cette loi de l’étranger qui par l’interdit de l’inceste, fonde le politique à travers l’art et empêche la sphère du social d’être corrompue par les intérêts privés. L’histoire de l’Occident en définitive, s’y résume : avoir brisé le pluralité du fatum de l’Antiquité en faisant de l’amour chrétien- l’amour de l’autre- (avant qu’il ne devienne un dogme), le paradigme à travers lequel l’Europe reconfigurait l’héritage gréco-latin. La centralité de la littérature dans ce processus est essentiel: la littérature n’est pas un élément parmi d’autres de ce récit aux côté des mythes, des légendes… elle est Le récit collectif.
C’est pourquoi le roman et les romanciers se trouvent au cœur de l’enjeu politique de la représentation. Si le poète est l’amont, le romancier est l’aval. En effet, le roman correspond aux grandes étapes de la construction de l’état moderne avec son endroit (la démocratie) et son avers (le totalitarisme). Le roman surgit en tant que forme au moment où une société cesse de croire à ses dieux et s’essaie à son autonomie et donc à un certain degré d’abstraction c’est-à-dire de métaphorisation. Métaphorisation qui est requise pour vivre dans une société. Mais la clef demeure la langue, bien sûr. La configuration , dirions-nous aujourd’hui, d’ une nouvelle langue véhiculaire (le vulgaire illustre au Moyen-Age, la langue nationale durant les lumière et le romantisme, le langage informatique aujourd’hui) induit naturellement une nouvelle forme de subjectivité et donc de narration.
Chaque époque vit les avatars de cette profanation qui peut conduire à l’idéologie, il est vrai. Les grandes oeuvres marquent ces passages et permettent de se reconnaître dans la diversité. C’est pour cela qu’elles sont les balises à partir desquelles se constitue un espace public qui tout en étant national est universel. Cette comparaison peut au demeurant réserver plusieurs surprises dont la première serait de s’apercevoir que les « écritures migrantes » ne sont pas nécessairement l’apanage des seuls «migrants». Et vice versa. Pour ne prendre que la cas du Québec, un écrivain « autochtone » tel un Hubert Aquin est beaucoup plus près de l’esthétique migrante -qui est l’esthétique même du roman- que nombre d’écrivains censés appartenir à cette catégorie et qui ne pratiquent en fait qu’une littérature du « petit contexte » avec des trémolos de nostalgie dans la voix. Du kitch dégoulinant de bons sentiments et de familialisme. N’est pas migrant qui veut !
Mais comment alors définir une esthétique migrante ? Est-ce le plurilinguisme, la subversion des genres ou, plus généralement, les dérives par le rapport à un point fixe qui pourraient alors la déterminer ? Nous pensons que non. Naguère alors que les modèles littéraires étaient relativement bien circonscrits par les manuels de référence, il était plus facile de transgresser les formes pour produire du neuf (ou pour le croire) et revendiquer du coup la posture du moderne. Mais depuis le milieu du siècle dernier après les chocs successifs de Proust, Joyce, Kafka, mais aussi de Beckett, et de Ionesco ces illustres transfuges de la langue française, cette posture est devenue à son tour un lieu commun, travaillée par l’idéologie. Il convient donc de rappeler ce que « la science du beau » tel que l’a voulu le philosophe allemand A. G. Baumgarten, a à voir avec, « le sensible, le perceptible ». C’est donc à partir d’une phénoménologie de la sensation qui est mouvement, émotion que peut s’élaborer des critères éthiques et esthétiques à partir desquels on serait en mesure d’apprécier un oeuvre. « Un soir j’ai assis la beauté sur mes genoux, je l’ai trouvée amère et je l’ai injuriée. » Ce vers qui ouvre Une saison en enfer de Rimbaud nous donne un indice sur ce qui se joue dans la réception du beau et qui nous semble au premier abord « amer», Dante dirait « acerbe». L’amertume de la beauté, c’est l’émotion ressentie face à ce qui, dans sa nouveauté même nous dépasse. Car le beau, le nouveau participent d’une loi qui n’appartient pas au monde familier. Cette loi est barbare, étrangère.
« Et le professeurs des littératures étrangères ? se demande encore Kundera, n’est ce pas leur mission toute naturelle d’étudier les œuvres dans le grand contexte de la Weltliterature ? Aucun espoir ! laisse tomber l’écrivain. Pour démontrer leur compétence d’experts, ils s’identifient ostensiblement au petit contexte national des littératures qu’ils enseignent. Aucun espoir, assène-t-il une seconde fois ; c’est dans les universités à l’étranger qu’une œuvre d’art est la plus profondément embourbée dans sa province natale. »
*
Mesdames et messieurs les canadianistes, les québécistes, il n’en tient qu’à vous de faire mentir les propos de Kundera. Il ne tient qu’à vous de jeter durant ce colloque les bases d’un vaste chantier qui conduira enfin à l’avènement de cette littérature mondiale entrevue par Dante et souhaité par Goethe.
Plus que jamais cette littérature mondiale est devenue une nécessité. Devant des espaces nationaux qui se rétrécissent comme peau de chagrin, devant l’implosion des espaces éditoriaux qui croulent sous la surproduction des pseudo romans marqués par une esthétique postnaturaliste du plus mauvais aloi, devant une critique journalistique inexistante… il devient urgent de réintroduire à la lettre la loi de l’étranger qui permettra de séparer ce qui participe du nouveau de ce qui, sous un vernis de modernité, demeure passéiste. Vous, plus que quiconque êtes préparé pour ce faire. En conclusion je formule le souhait que l’on compare non seulement les écritures migrantes lusophones, hispaniques, italiennes, anglo-saxonnes, néerlandaises entre elles mais aussi avec les textes de « l’internationale dénationalisée des créateurs » dont « le centre est partout et nulle part » afin que, par cette mise en relation, puisse émerger une véritable littérature mondiale. C’est à mes yeux la seule mais grande utilité des écritures migrantes.


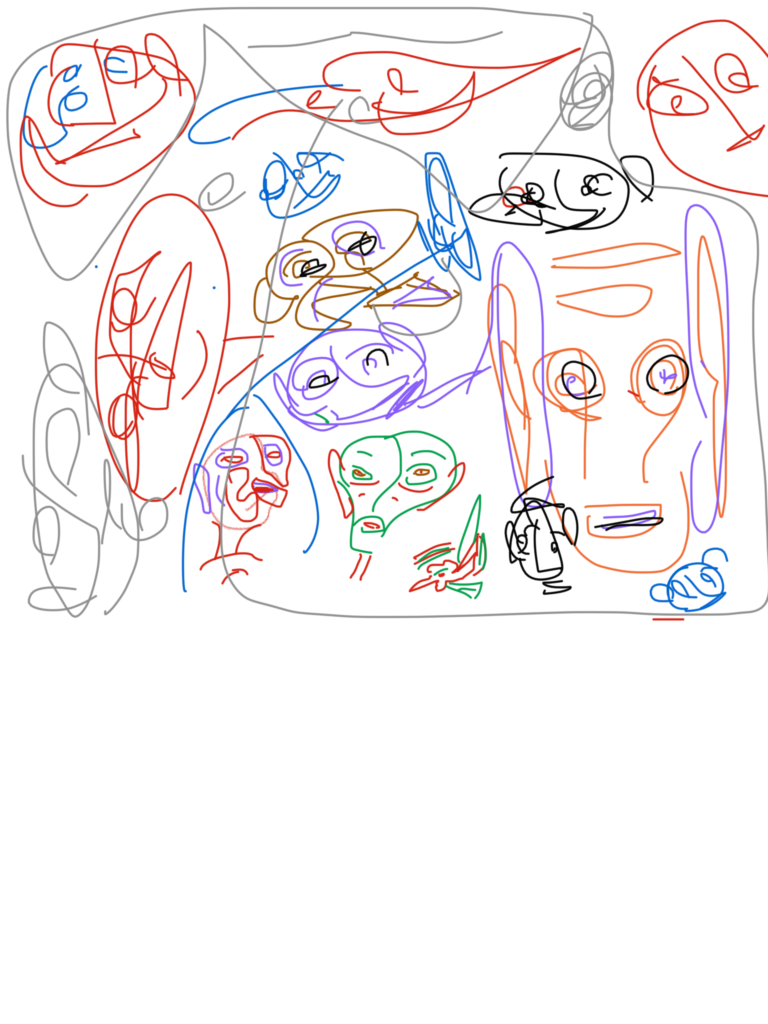 Ce texte est celui de l’allocution d’ouverture du colloque “1985-2005 : vingt ans d’écriture migrante au Québec. Les voies d’une herméneutique”, ( Marc Arino et Marie-Lyne Piccione) Presses universitaires de Bordeaux, 2007.
Ce texte est celui de l’allocution d’ouverture du colloque “1985-2005 : vingt ans d’écriture migrante au Québec. Les voies d’une herméneutique”, ( Marc Arino et Marie-Lyne Piccione) Presses universitaires de Bordeaux, 2007. 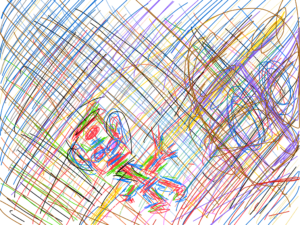

 Il y a tout de même un triptyque gagnant dans cette étape numérique de l’
Il y a tout de même un triptyque gagnant dans cette étape numérique de l’