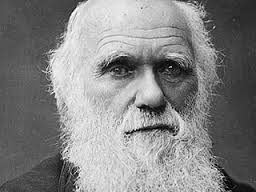par Christian Roy

Établi à Griffintown en bordure du Vieux-Montréal au début de l’avalanche immobilière balayant ce qui fut le premier quartier ouvrier et « ethnique » au Canada, j’entends avec appréhension se rapprocher de jour en jour et d’heure en heure, derrière le mur de nouveaux condos venus m’en couper la vue entretemps, le claquement des crocs métalliques en train de déglutir par les deux bouts l’Autoroute Bonaventure. En osant me rapprocher du chantier, j’ai vu les mâchoires décrochées de certains de ces tyrannosaures mécaniques reposer dans la poussière telles les idoles de dieux-condors précolombiens au plumage en crochets, au bec acéré et à l’œil opaque. Leur rumeur inexorable et menaçante juste au-delà de l’horizon lorsque les monstres sont en action me rappelle les Langoliers de Stephen King, ces espèces d’enzymes voraces qui, dans le récit éponyme adapté au petit écran il y a vingt ans, grugent les mondes figés (tel en l’occurrence l’aéroport de Bangor) que laissent derrière eux tous les instants dans une voie de garage du temps, afin de les consigner au néant béant en arrière-plan. Car c’est bien tout un pan du passé qui est sur le point d’y basculer sans reste avec les derniers tronçons de cette artère aérienne. —De mon passé en tout cas, puisque si je me suis fixé pour ainsi dire à l’ombre de l’Autoroute Bonaventure, c’est qu’un mystérieux tropisme de ma psychogéographie personnelle a fini par me ramener en ce lieu magique d’une expérience fondatrice.


Mes premières sorties en ville pour échapper adolescent à ma lointaine banlieue avaient en effet pour destination le Musée d’art contemporain à son ancien site de la Cité du Havre. C’était alors toute une expédition avec le rare autobus partant du métro McGill pour emprunter le parcours immortalisé dans une fameuse performance photographique de Françoise Sullivan, longeant comme par la voie des airs les alignements cyclopéens des silos à céréales et autres structures industrielles monumentales, pour finalement atterrir dans un quadrilatère bordé d’énigmatiques complexes de béton de faible hauteur, aux airs d’inexplicables sanctuaires d’une race inconnue ou de bases secrètes de recherche interplanétaire ou transdimensionnelle. Je trouverais bien plus tard l’écho de ce trajet initiatique dans certains films de Tarkovski, que ce soit la Zone hantée parcourue de voies ferrées de Stalker ou la longue randonnée silencieuse sur une autostrade de Tokyo dans Solaris.


Le charme unique de l’Autoroute Bonaventure tient justement pour une part à un sens quasi « japonais » de l’espace, ou plus exactement de l’espacement (ma) : non seulement le large panorama planant d’un entrelacs de canaux et de chemins de fer, de caissons monolithiques et de chantiers délabrés, mais sous le tablier, la galerie ouverte au plafond strié sur la longueur, sereinement rythmée vers le point de fuite par les poutres des travées, modulées d’angles obtus à leurs extrémités. À la fois trapus et spacieux, ces larges portails ouvrent l’un sur l’autre jusqu’à l’infini, avant d’épouser la courbe survolant le canal de Lachine, plantés dans les eaux ombreuses de ce creuset de l’industrialisation comme des torii dans une onde côtière en pleine nature… Je me console de ce que ceux qui sont ainsi du ressort portuaire du gouvernement fédéral resteront intouchés par la démolition de l’autoroute à partir de sa jonction avec la ville de Montréal. Je me désole néanmoins qu’on ait fait la sourde oreille aux nombreuses interventions et propositions de citoyens, avant, pendant et après les consultations publiques en vue de la bonification du Projet Bonaventure, plaidant pour la préservation d’au moins un tronçon de cet espace irremplaçable en terre ferme, propre à accueillir de multiples usages urbains : « High Line » végétalisé au-dessus et « mail » piétonnier en-dessous[1], ou ne serait-ce qu’un seul « torii » comme observatoire urbain et ironique « arc de triomphalisme », témoin des lendemains qui chantaient encore avec un reste touchant de naïveté à l’apogée de la course à l’espace. Bien que dans une tout autre visée, Tarkovski pouvait alors, sous couvert du futurisme officiel d’une tyrannie progressiste, prendre une telle autoroute ultramoderne comme piste de décollage vers d’inimaginables mondes lointains où tout demeurait éternellement possible. À bien y penser, le MAC était en quelque sorte mon Solaris à moi, et Bonaventure la passerelle vers cette Planète Sauvage de l’art contemporain (pour évoquer un autre classique du genre par Roland Topor sorti alors), qui trouvait son environnement « naturel » dans un paysage industriel dénaturalisé, et partant, poétisé.
Même au-delà de l’anecdote personnelle, voire générationnelle, il serait dommage d’oublier sans au moins une pensée attendrie que l’Autoroute Bonaventure se voulut un pont vers l’An 2000, comme entrée de ville au moment où Montréal fut pour une saison (répercutée sur une décennie —heureusement pour ceux qui comme moi n’ont connu Terre des Hommes qu’après l’Expo 1967) le modèle réduit du village global électronique décrit en même temps par McLuhan de Toronto. En ce centenaire du Canada, le XXe siècle lui appartint bel et bien selon la prophétie de Laurier, fût-ce pour le quart d’heure de célébrité mondiale promis par Warhol à chaque humain de la nouvelle ère qui s’y inaugurait. Cet An 2000 où je trouvais alors volontiers refuge, autorisant tous les espoirs, ou du moins toutes les rêveries, non sans la crainte qui se mêle à l’exaltation au seuil des grandes aventures, n’exista vraiment qu’autour de 1970, quand il sembla pendant quelques années juste à portée de la main, derrière le prochain tournant, avant que le Progrès, emporté par sa propre dynamique, ne déraille pour de bon dans la spirale d’un malstrom dont nous ne voyons plus le fond. Ne pourrions-nous du moins honorer en toute lucidité les illusions de cette époque où l’on liquida allègrement en son nom tant de vestiges d’époques révolues, avec un dédain de taliban des savoir-faire et des univers de sens de tant de générations antérieures ?
En effet, en déniant inconsidérément toute valeur esthétique ou patrimoniale aux réussites de l’architecture brutaliste des années 1960-70, nous perpétuons l’arrogant irrespect pour le passé du modernisme niais qui l’inspirait, au lieu d’inclure ce dernier dans la considération distanciée d’une postmodernité éclairée pour toutes les époques —y compris celle qui prétendit supplanter sans état d’âme l’héritage des précédentes. L’Avenir alors entrevu n’est plus ce qu’il était, je suis le premier à l’admettre et même à m’en féliciter ; mais ce mirage fait partie intégrante de notre passé, à l’égal de tout autre mythe ou mode d’être historiquement spécifique, dont on s’efforce pieusement de conserver ou reconstituer les pendants architecturaux dès qu’il s’agit de ses victimes. L’obstination des autorités à détruire complètement la portion urbaine de l’Autoroute Bonaventure est particulièrement regrettable, alors que l’on s’apprête pourtant à intégrer dans un tel esprit l’an prochain le cinquantenaire de l’Expo 67, en vue de laquelle elle fut conçue, dans une nouvelle célébration de la Confédération en même temps que des 375 ans de Montréal.


On veut nous faire croire que les neuf voies de la nouvelle entrée de ville mise à plat auront l’effet paradoxal de cicatriser la balafre dont l’Autoroute Bonaventure lacéra le tissu urbain de Griffintown avec ses neuf voies surélevées (s’ajoutant aux cinq voies de surface des rues adjacentes), coup fatal redoublant la blessure déjà infligée pendant la guerre par le viaduc ferroviaire —qui reste d’ailleurs intouché en dépit de son délabrement. Il est permis de soupçonner que ce curieux calcul répète au moins autant qu’il ne la compense la belle inconscience avec lequel cet ouvrage d’art fut implanté dans Griffintown pour achever de le condamner en tant que quartier habité. Quarante ans plus tard, j’ai pourtant découvert celui-ci dans un état transitionnel de formidable catalyseur local et international de projets et initiatives de réinvention urbaine à même la sédimentation du passé et les interstices du développement. Malheureusement, le cours du raz-de-marée d’une promotion immobilière peu planifiée et le plus souvent mal inspirée ne fut guère affecté par toute cette créativité citoyenne de terrain.

Je peine à retrouver quelque trace du Griffintown d’il y a à peine un lustre encore, incubateur d’expériences inouïes pour faire du neuf à même le Vieux, à l’ombre des gratte-ciels qui se bousculent pour l’enjamber, tels les tripodes géants des envahisseurs martiens de La Guerre des mondes. Leur irrésistible avancée va de pair avec l’élargissement du fossé qui nous sépare du passé industriel et de ses monuments, et à travers eux, de l’Avenir qu’ils incarnaient. C’est son souvenir palpable qu’on efface avec toute trace de l’Autoroute Bonaventure, dont le nom même était promesse de ce bel Avenir. Aussi ne suis-je pas seulement triste, mais quelque peu angoissé de la voir disparaître un peu plus chaque jour derrière l’horizon de la prétérition. Symbolisé par elle, c’est bien sûr l’An 2000 qui s’éloigne irrémédiablement de nous dans le passé, soit le rêve utopique qui lui conféra une réalité quasi palpable vers 1970 —bien plus que l’imperceptible tournant du millénaire au calendrier. Or, au fil d’une actualité lourde d’absurde fatalité, je ne puis m’empêcher d’être hanté par l’obscure crainte que l’avenir en ce sens premier ne soit aussi emporté avec le vestige routier de son rêve daté, en cet été qui a quelque chose des derniers mois de la Belle Époque du siècle dernier où le sort d’un monde vacillait au ralenti au bord de l’abîme d’une démolition méthodique, avec en prime l’incrédule déjà-vu du funeste épilogue à son tiers.

[1] Voir Marc-André Carignan, « Est-il trop tard pour un High Line montréalais ? », Métro, 4 février 2016, http://journalmetro.com/opinions/paysages-fabriques/912818/est-il-trop-tard-pour-un-high-line-montrealais/.


 Paris, dix-huitième arrondissement.
Paris, dix-huitième arrondissement.